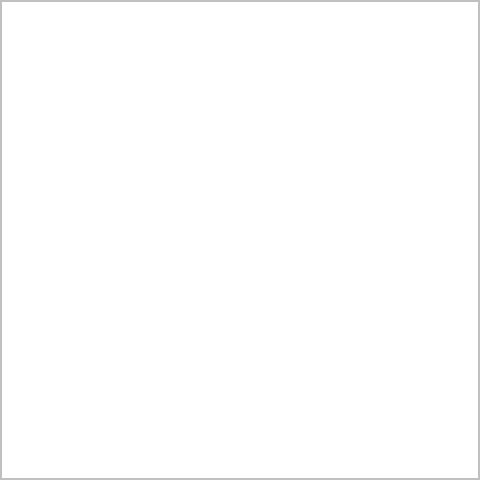Nous entrâmes dans la quarantaine comme dans un mauvais rêve. Le transport avait été logé dans deux blocks : le 13 et le 23. Le 13, assez petit, dut abriter quatre cents femmes. Ces baraques étaient toutes construites sur le même modèle : l'entrée, au milieu, donnait sur le lavabo, les W.C. et le bureau de la femme chef de block. Les deux côtés A et B, rigoureusement symétriques, comportaient un dortoir et une pièce où nous étions parquées le jour. Normalement, chaque côté était prévu pour une centaine de pensionnaires, ou, plus exactement, pour deux équipes de cinquante travaillant l'une de jour, l'autre de nuit, de sorte qu'elles occupaient les lieux alternativement. Or, nous étions deux cents à vivre parquées dans une pièce où l'espace avait été strictement mesuré pour cinquante. En somme, c'était la vie au block 26 qui recommençait, mais étranglée désormais par le règlement impitoyable du camp.
Durant nos quatre semaines de quarantaine, nous ne devions ni travailler, ni sortir du block. Mais la vie n'en était pas moins réglée sur l'horaire des travailleuses : lever au coup de sirène de trois heures et demie ; on avait tout juste le temps de s'habiller et de faire son lit de façon impeccable. Puis, le dortoir balayé, était fermé à clef pour la journée.
A quatre heures, nouveau coup de sirène, le camp entier se précipitait à l'appel. Il faisait nuit noire, et il y avait de la neige. Nous voyions les femmes courir : certaines d'entre elles, des juives néerlandaises, traînaient après elles des petits enfants de trois à dix ans. On en avait pour une heure à rester plantées dans le noir, en attendant que la « Aufseherin » vint faire l'appel : les travailleuses étaient massées en bataillons sur la « Lagerstrasse », l'énorme place devant les cuisines ; les blocks en quarantaine posaient devant leurs baraques. Au total, cela faisait environ vingt mille femmes à compter. Si tout allait bien, l'opération durait une heure. S'il y avait erreur dans l'addition, et le cas était fréquent, l'attente se prolongeait à volonté. La seule distraction était de regarder le mur vert sombre de la baraque et, au-dessus, le ciel nocturne qui pâlissait lentement.
Quand je suis arrivée au block 13, en février 1943, le soleil se levait à l'extrémité droite du toit ; quand je l'ai quitté fin juillet, il se levait à l'extrémité gauche. Ce fut le seul changement dans le décor. Généralement, l'on tenait une demi-heure sans bouger. Puis, de-ci de-là, une femme tombait raide de froid ou de fatigue. On la ramassait, on l'étendait sur une table, salle illuminée, dont toutes les fenêtres étaient grandes ouvertes, et l'on se remettait au garde à vous. Quand la « Aufseherin » arrivait elle comptait les femmes debout et les quatre ou cinq allongées qui garnissaient chaque salle.
Quand enfin retentissait le coup de sirène final, nous rentrions en nous bousculant dans le couloir trop étroit. Mais pour les travailleuses commençait une autre cérémonie, l'appel du travail, pendant lequel on distribuait les corvées aux équipes. Cela durait encore une fois une heure, de sorte que les femmes abordaient leurs douze heures de travail forcé avec deux heures de piquet dans les jambes. Pendant ce temps, les « privilégiées » de la quarantaine jouaient aux sardines empilées dans la boîte.