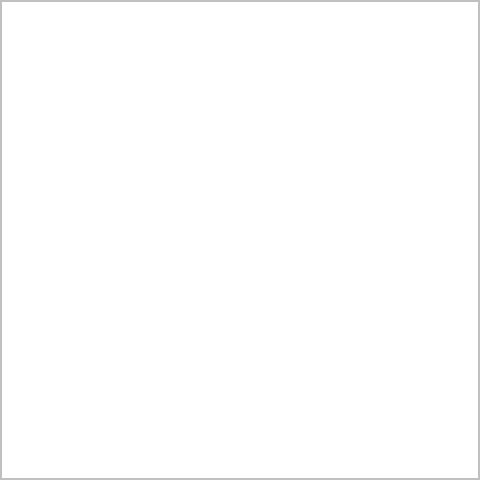L'usine, où les détenus du camp de Monowitz travaillaient, était un ensemble industriel de grande envergure. Entreprise par la firme allemande I.G. Farben-Industrie, après l'annexion de la Pologne, elle couvrait une superficie considérable. Le camp de Monowitz, où je me trouvais, avait été installé en bordure de l'usine, le long de la route reliant la Haute Silésie à Cracovie, et ceci afin de constituer une réserve de main d'œuvre, sans doute peu productive, mais très bon marché et inépuisable, car alimentée, au fur et à mesure des besoins, par le Camp Central voisin d'Auschwitz-Birkenau.
Bien entendu, les déportés ne recevaient aucun salaire, si ce n'est, à deux ou trois reprises, des bons appellés « Primeshein », indiquant une certaine somme en marks ou pfennigs, mais dont nous n'avions que faire. En effet, ces bons ne pouvaient servir à rien, puisqu'il n'y avait aucun magasin ou cantine. Ils ne devaient pas avoir cours en dehors du camp, car ils n'avaient non plus aucune valeur d'échange avec les civils allemands ou étrangers avec lesquels nous avions, à l'usine, quelques contacts. Curieuses contradictions du Régime Concentrationnaire !
Cette vaste usine, donc, appelée « Buna », comportait d'importants ateliers de chimie et pétrochimie. En fait, d'après ce que j'en entendais dire et ce que je voyais en la traversant chaque jour, elle comportait une unité de fabrication de carburants synthétiques, indispensables à l'effort de guerre, la production de pétrole naturel n'étant pas suffisante en Allemagne et dans les territoires occupés. De même, la Buna utilisait les hydrocarbures de synthèse qu'elle fabriquait pour faire des caoutchoucs également synthétiques nécessaires pour la fabrication de pneus et de chenilles de chars.
Il s'agissait donc d'un ensemble industriel exclusivement conçu pour satisfaire les besoins des forces armées du Reich et il fallait s'attendre à ce qu'il serve, un jour ou l'autre, de cible à l'aviation anglo-américaine. Lorsque nous y sommes arrivés, en Juillet 1944, la Buna n'avait pas encore été bombardée. Sans doute, les Alliés attendaient-ils que les travaux de construction et d'équipement soient plus avancés, afin de détruire des unités achevées plutôt que des chantiers. Sans doute, également, la présence, connue d'eux de déportés, mais également de prisonniers de guerre anglais et de travailleurs civils requis dans les pays occupés, posait-elle un sérieux problème pour prendre la décision d'un bombardement massif.
Quoiqu'il en soit, une première alerte eut lieu effectivement durant le mois d'Août vers la fin de la matinée. Les sirènes se mirent à mugir et les soldats et travailleurs civils à courir dans tous les sens. Aucun abri n'était prévu pour les déportés et je me souviens d'avoir couru, isolé, un peu au hasard, cherchant un terrain découvert pour éviter d'être écrasé par l'écroulement d'un bâtiment.
Je me suis retrouvé, assis sur un tas de détritus, avec quelques prisonniers anglais, sans surveillance comme moi. J'ai pu ainsi leur parler, en anglais, le temps de l'alerte, ce qui a été pour moi une grande joie. Ils avaient été fait prisonniers à Tobrouk, durant la campagne de Cyrénaïque. L'un d'eux avait sur lui un peu de pain qu'il m'a donné. Soudain, nous avons vu, très haut dans le ciel bleu, passer un nombre considérable d'avions. Quelques bombes tombèrent sur l'usine, mais assez loin de l'endroit où nous étions. Il semble que l'essentiel du bombardement était destiné aux ensembles industriels proches de la région de Gleiwitz et Katovice.
Les sirènes sonnèrent la fin de l'alerte; je me séparais de mes amis anglais, à qui j'avais pu expliquer ce qu'étaient ces larves humaines, squelettiques, sales, habillées en bagnards, dont ils ne comprenaient pas bien la situation.
Cette première apparition de l'aviation alliée avait constitué pour moi, en définitive, un moment agréable.
Il n'en a pas été de même pour l'opération suivante, menée par l'aviation américaine, contre la Buna, dans les semaines qui suivirent, le 20 Août exactement.
C'était un dimanche matin, jour choisi sans doute par les Alliés parce qu'ils pensaient que les déportés, prisonniers de guerre et travailleurs étrangers ne seraient pas sur le site de l'usine. C'était partiellement vrai, sauf pour une partie des Kommandos du camp de Monowitz qui travaillait ce dimanche, dont le mien.
Même sirène d'alerte, mais beaucoup plus de nervosité des militaires et civils allemands. De nouveau, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Au bruit des avions qui se rapprochent, s'ajoute bientôt celui des bombes. J'entends distinctement, tout autour de moi, le sifflement caractéristique des bombes qui tombent et se rapprochent, puis l'explosion au sol. J'ai l'impression très désagréable d'être au centre de l'objectif et je cours comme un lapin, pour tenter de me mettre à l'abri, avec une rapidité et des forces que je ne croyais plus avoir et qui étaient dues, sans doute, à l'instinct de conservation.
De nombreuses bombes tombent et explosent tout près de moi. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il serait vraiment absurde d'être tué par des bombes américaines.
Cependant, je suis sincèrement étonné que les dégâts occasionnés par les explosions soient si peu importants et, que je ne sois pas moi-même commotionné. Il s'agit sans doute de projectiles relativement peu puissants. Toutefois, je sens soudain une brûlure sur une main : c'est un peu de plomb fondu coulant sans doute d'un tuyau ; très légère blessure sans conséquence et sans suite.
Plusieurs vagues d'avions déversent leurs bombes, puis c'est l'accalmie et le silence.
Regroupés et ramenés au camp, nous constatons, dans l'usine, la destruction de nombreux bâtiments et l'écroulement de colonnes de distillation de produits pétroliers. Le camp lui-même n’a pas été touché. Nous apprenons, dans l'après-midi, qu'il y a eu, heureusement, très peu de victimes parmi les déportés travaillant à l'usine.
La reconstruction a été entreprise dès le lendemain et nous avons pu constater qu'elle se réalisait très rapidement. Nous étions, bien entendu, privés de toute nouvelle de l'extérieur, ne recevant ni lettre, ni colis. Les informations provenaient, jusque récemment, des nouveaux détenus, mais l'avance Alliée avait ralenti le rythme des convois. Le mien avait été le dernier en provenance de France, à l'exception d'un groupe de Lorrains qui nous apporta quelques informations sur la progression des opérations militaires depuis le débarquement.
De même, nous avons appris, par des civils travaillant à l'usine, mais sans que nous puissions en avoir confirmation, qu'un attentat contre Hitler avait eu lieu durant ce mois d'Août.
Bien entendu, cette information avait fait naître l'espoir d'un renversement rapide du régime, avec d'heureuses conséquences sur l'évolution de la guerre et le régime des camps de concentration. Nous avons rapidement compris que, s'il avait bien eu lieu, l'attentat avait échoué et que rien, bien au contraire, n'était modifié dans le comportement des S.S. à notre égard.