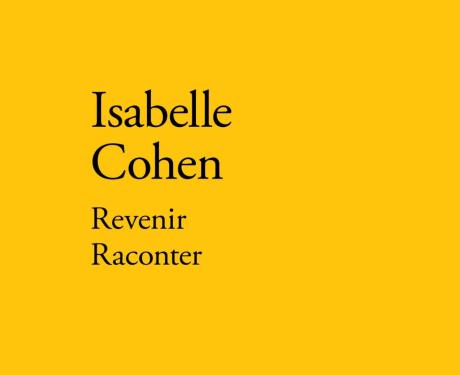Rencontre avec Isabelle Cohen,
auteure de Revenir-Raconter-Portrait de ma mère au subjonctif imparfait,
publié par les Éditions Verdier en 2024.
 | Isabelle Cohen a écrit en juillet 2016 : « J’ai arrêté de travailler sur ta biographie de manière linéaire et académique ». Et de fait elle a construit un abécédaire de A à Z sur le nom si lourd, si chargé de douleurs d’Auschwitz : « la destruction de A à Z, la destruction de la langue et de la culture yiddish parties en fumée avec des millions d’êtres vivants, la destruction de l’idée d’humanité ». Ce faisant, elle a écrit un livre très original, à la fois personnel et familial, poétique et politique. Revenir-Raconter transmet des connaissances inattendues dans une langue innovante, une infinité de faits petits et grands concernant la famille Nordmann Cohen, les résistances et les déportations, le témoignage sur le système concentrationnaire, dans ses formes multiples et nécessaires, la sororité qui n’a cessé de relier à leurs camarades déportées du convoi du 24 janvier 1943, dit des 31 000, vivantes ou mortes, les survivantes devenues écrivains de la déportation, dans une amitié indéfectible avec Charlotte Delbo. De l’assemblage alphabétique, comme dans un kaléidoscope, se dégage un portrait sensible et juste de Marie‑Elisa Nordmann Cohen, personne privée, mère aimée et admirée, et personnalité publique, longtemps présidente de l’Amicale d’Auschwitz et des camps de Haute Silésie.
Une ascendance juive et un destin français, depuis des générations.
Marie‑Elisa Nordmann est née le 4 novembre 1910, rue de Florence, 8e arrondissement de Paris, fille ainée de Bernard Nordmann (1869‑1937), adhérent de la Ligue des Droits de l’Homme, en référence à l’Affaire Dreyfus, et d’Athénaïs / Jeannine Nattan (1880‑1942), qui ne cessera de seconder sa fille, depuis l’aide aux Républicains espagnols jusqu’à la solidarité active, avec les Résistantes, tant Marie‑Elisa que leur amie France Bloch, engagée dans les FTP. L’enfance fut vécue sans histoires, malgré les deuils familiaux et les difficultés professionnelles de son père, la jeune fille fit de brillantes études scientifiques et littéraires, bachelière, puis ingénieure chimiste en 1931 ; docteure ès sciences en 1937, elle ne cessera de travailler comme chercheur scientifique. De sa naissance à sa mort, en 1993, sauf les 27 mois d’internement en camps, elle a vécu dans des lieux qui lui étaient chers, à Paris (13e) et dans sa maison d’Ardèche. De son premier mariage avec Paul Rumpf, d’affiliation protestante, dont elle divorça, elle eut un fils, Francis, né en 1936. À la déclaration de guerre, en exode à Bordeaux, elle fut requise civil dans l’inspection médico‑physiologique de l’armée de l’air, à Mérignac. Rentrée à Paris, à l’été de 1940, elle ne se déclara pas et entra en résistance clandestine dès septembre. Sa mère devenue veuve, fut arrêtée, à leur domicile, au petit matin, comme otage, le 7 août 1942, alors qu’elle même était déjà détenue au Dépôt. Agée de 62 ans, Bonne-Maman comme l’appelle sa petite fille, fut internée à Drancy, puis déportée comme Juive, le 18 septembre 1942, gazée à son arrivée à Birkenau. Mères à leur tour, isolées et résistantes, Marie‑Elisa avec son amie France Bloch, eurent conscience que leurs fils étant menacés, il fallait envisager de les confier à des relations familiales ou familières : Francis, chez son oncle et sa tante, Philippe et Paule Nordmann, Roland sauvé par la femme de ménage et amie de France : A.Touchet.
|
Résistances, arrestations et déportations (1934-1944).
M‑E.Nordmann s’engagea, dès 1934, dans le comité de vigilance des intellectuels antifascistes (CVIA), puis dans le Comité mondial des femmes contre la guerre et le fascisme, en 1936, avertie qu’elle était, de la nature politique et idéologique du nazisme, par deux voyages en Allemagne au début des années trente. Après son adhésion au PCF, en septembre 1940, elle entra dans la résistance politique, à caractère patriotique et antifasciste, dans le Front national universitaire. Elle participait à la rédaction et à la diffusion de « L’Université libre », puis de « La Pensée libre », aux cotés de ses amis Jacques Solomon, qu’elle hébergea et Hélène Langevin Solomon, avec qui elle fut emprisonnée, elle secondait aussi France Bloch, en charge de la production d’explosifs pour la résistance armée, en lui apportant mercure et glycérine qu’elle soustrayait à son laboratoire. C’est sans doute pour cela qu’elle fut repérée par La BS (brigade spéciale de la Préfecture de police) identifiée par la plaque d’immatriculation de son vélo, et arrêtée le 16 mai 1942. Dans sa famille de Résistants, il y avait aussi son frère Philippe, professeur de lettres résistant dès novembre 1940, interrégional FTP puis combattant FFI, en Bretagne, arrêté le 25 mai 1944, déporté à Neuengamme, mort du typhus à Bergen Belsen, en 1945, et un cousin, Léon‑ Maurice Nordmann, avocat, résistant dès août 1940 (Réseau du Musée de l’homme), fusillé le 23 février 1942, au Mt Valérien, qui eut le courage inouï de marcher à la mort en chantant La Marseillaise ?
Détenue au Dépôt, jusqu’au 24 août 1942, puis à La Santé, jusqu’au 29 septembre, elle fut incarcérée dans le Fort de Romainville, où se préparait le convoi de résistantes, majoritairement communistes, qui partit de Compiègne le 24 janvier 1943, à destination d’Auschwitz Birkenau.
À ce que fut son expérience de la « Descente aux enfers » :
« tu t’es éreintée dans les commandos de briques et de démolition, puis tu as passé trois semaines au Revier, avec otite, pneumonie et dysenterie », telle qu’elle en a écrit l’histoire dans sa postface au livre de Wladimir Pozner, et telle qu’elle est rapportée dans le livre de Charlotte Delbo, sa fille n’ajoutera rien à un réquisitoire impitoyable contre le système concentrationnaire, transformé par les nazis en centre de mise à mort des Juifs d’Europe.
Ce qu’elle a transmis à ses enfants, c’est l’exceptionnelle solidarité qui lui a sauvé la vie, à plusieurs reprises, et d’abord le fait d’avoir été une des 17 affectées dans un camp auxiliaire d’Auschwitz Raïsko, le 21 mars 1943, suite à l’intervention décisive de Claudette Bloch et d’Annie Binder, auprès de l’officier SS dirigeant le laboratoire d’agronomie, Joachim Caesar, en liaison directe avec H.Himmler, demandeur de main d’œuvre spécialisée. Grace aussi aux apports multiples d’Eugène Garnier, un ancien déporté résistant arrivé à Auschwitz par le convoi des 45 000 du 6 juillet 1942.Certes il y avait toujours « la faim, la peur d’être prise, les barbelés, les sentinelles, le froid intense »... sauf qu’ « à Raïsko, on ne nous battait pas... mais, à la moindre faute, on vous envoyait à la mort » , témoignera Simone Alizon. Elles y restèrent jusqu’au mois d’août 1944.
Le 14 août 1944, elles furent transférées dans le camp de femmes, déportées NN à Ravensbrück, la « petite Sibérie Mecklembourgeoise » et Marie Elisa Nordmann fut affectée au laboratoire du Revier, infirmerie où elle vit des médecins pratiquer des expérimentations pseudo-scientifiques visant à stériliser des femmes tsiganes ou des opérations d’ablation des organes génitaux, y compris sur des petites filles auxquelles elle put donner des soins, faits criminels consignés dans le rapport qu’elle exposa au Ministère des anciens combattants et victimes de guerre, le 19 juin 1945. Elle fut encore internée un peu plus d’un mois, à partir du 2 mars 1945, dans le camp de Mauthausen, « camp terrible », de nouveau infirmière, comme Marie Josée Chombart de Lauwe. Sa fille écrit que les déportées du convoi des 31 000 « étaient encore une main d’œuvre gratuite à déblayer les voies de chemin de fer bombardées par les Américains, à mains nues ». Avant la libération du camp par l’armée américaine, le 5 mai 1945, elles furent monnaie d’échange entre le comte suèdois Bernadotte et H.Himmler, et le 22 avril, convoyées par la Croix rouge, en camions, via la Suisse (St Gall) jusqu’à la frontière française, enfin elle fut rapatriée à Paris, le 30 avril.
Présidente de l’Amicale d’Auschwitz de 1950 à 1991 puis honoraire Isabelle Cohen écrit : « L’amicale tes copines de déportation étaient ton souci quotidien, pas un jour sans, pas un jour sans la déportation, ce depuis le premier jour de ton retour ». Marie‑Elisa Nordmann est devenue membre du conseil d’administration de l’Amicale, dès juin 1945 et elle a assumé toutes les taches de la fonction de présidente, en interne, avec la secrétaire générale, Louise Alcan, et en externe, dans le comité international d’Auschwitz, tout en travaillant professionnellement et en élevant ses trois plus jeunes enfants. D’abord dans les commémorations publiques de la libération d’Auschwitz et des camps de concentration. C’est ainsi qu’elle a prononcé le discours officiel à Birkenau, en avril 1955, devant 100 000 personnes, tenu des assemblées générales annuelles, doublées de rencontres dans la salle des Fêtes de la Mairie du 4e, ajoutant aux rapports moral et d’activité, une intervention de M‑L.Kahn, sur la solidarité, l’aide sociale aux survivants et aux familles de déportés, sans jamais oublier l’aide morale, l’accueil, parce qu’elle savait d’expérience que si « la parole avait été, défense, réconfort, espoir », elle pouvait devenir sollicitude et reconstruction.
Elle écrivait, témoignait, transmettait, elle le fit toute sa vie, sans relâche. Elle écrivit d’abord des lettres, lettres de prison, lettres codées envoyées d’Auschwitz, tant qu’elles furent tolérées par la censure, elle reconstitua de mémoire, à Raïsko, la liste écrite des noms de ses camarades de convoi, qui fut à la base de la publication du livre de Charlotte Delbo sur « Le convoi du 24 janvier » par les Editions de Minuit, en 1965. Elle écrivit des préfaces comme pour le livre de Liliane Lévy Osbert « Jeunesse vers l’abime », des postfaces dont une remarquable « Histoire des camps d’Auschwitz » dans le livre de Vladimir Pozner « Descente aux enfers récits de déportés et de SS d’Auschwitz » publié par Julliard en 1980. Elle fut, dès son retour de déportation, un inlassable, et implacable, témoin, d’abord dans dans ses dépositions, au second procès d’Auschwitz, à Francfort, en 1963‑1965, où elle dénonçait les limites de l’accusation, à seulement 22 prévenus, à titre personnel, pour crime d’initiative individuelle et dans celui intenté, en 1964, à Paul Rassinier entre autres négationnistes être visionnistes, comme dans son soutien à son amie résistante polonaise internée à Auschwitz : Wanda Jakubowska, metteur en scène calomniée du film « La dernière étape » sorti en France en 1948, et à ces « femmes diffamées » que furent aussi Marie‑Claude Vaillant Couturier, immatriculée 31685 à son arrivée à Auschwitz et Macha Ravine (35552). Elle fut encore un acteur majeur de la transmission de l’histoire de la déportation et de la Shoah, s’adressant aux jeunes, aux élèves et à leurs professeurs, organisant le premier voyage d’étude à Auschwitz, en 1987. Elle participait enfin, en première ligne, à des associations de mémoires de l’internement et de la déportation, comme la FNDIRP, à des jurys du concours national de la Résistance et de la Déportation et du prix Marcel Paul.
De la personnalité de sa mère « Juive rentrée, mais communiste avant tout », le livre d’Isabelle Cohen ne cache rien, et c’est ce qui fait sa grandeur, en hommage à une femme d’exception qui voulait « montrer et démontrer que les atrocités nazies étaient le fruit voulu d’un état raciste (et antisémite)», qu’il y avait « un droit personnel et inaliénable à la dignité » (de tout être humain) et que « Vichy avait dénaturé le sens du civisme » alors que « la Résistance (telle qu’elle l’avait vécue en France occupée) avait été le creuset dans lequel se forgèrent les Droits de l’homme ».
Histoire et mémoire de Marie-Elisa Nordmann Cohen(1910-1993) par Marie-Paule Hervieu, membre du Conseil d’administration de l’UDA
Née à Paris, dans le 8e, Marie‑Elisa, comme l’appelaient affectueusement ses camarades, anciens déportés de l’Amicale d’Auschwitz, fut leur présidente de 1950 à 1991. D’ascendance juive, après de brillantes études scientifiques, elle devint ingénieur chimiste, diplômée de l’École de Physique et de Chimie industrielles de Paris, puis Docteur ès sciences en 1937, ce qui lui fut d’un grand recours pendant sa déportation. Engagée très tôt à gauche, elle fut, dès 1934, adhérente du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, y rencontra sa grande amie, France Bloch, qu’elle seconda dans son action de résistante FTP. Jeune mère de famille, bientôt divorcée, elle eut en responsabilité son premier fils, Francis Rumpf, et sa mère Athénaïs Nordmann, arrêtée comme otage à son domicile, le 7 août 1942, puis déportée comme Juive, de Drancy, par le convoi 34 du 18 septembre 1942, gazée à Birkenau, à l’age de 62 ans ; elle‑même étant déjà arrêtée, en attente de déportation... Devenue adhérente du parti communiste français à l’automne 1940, elle entra en résistance politique dans « L’Université libre » clandestine, en 1941‑1942 et fut en rapport avec le réseau du Musée de l’homme dont faisait partie son cousin Léon‑Maurice Nordmann, jusqu’à son arrestation, le 16 mai 1942, en même temps que France Bloch Sérazin qui sera jugée et condamnée à mort (guillotinée en Allemagne). Marie-Elisa est emprisonnée au Dépôt, à la Santé et dans le fort de Romainville. Elle fait partie du convoi politique de 230 femmes déportées à Auschwitz, par le convoi dit des 31 000, celui de Charlotte Delbo, parti de Compiègne le 24 janvier 1943. À Birkenau, elle a travaillé aux briques et aux démolitions, puis au Canada, est entrée au Revier pour dysenterie, et le 21 mars 1943, grâce à Claudette Bloch, elle est affectée au Kommando de Raïsko, au laboratoire de recherche sur le Kok‑saghyz, sorte de pissenlit devant permettre de produire du latex pour assouplir le caoutchouc synthétique, dont l’industrie de guerre allemande avait besoin, en vain. Parallèlement, elle n’a cessé d’aider et de secourir ses camarades déportées, ce que rappellent de multiples témoignages. Le 14 août 1944, elle est transférée dans le camp de Ravensbrück, où elle devient laborantine au Revier, puis repliée à Mauthausen (Autriche, dans le Grand Reich) où elle est infirmière ; elle est libérée le 22 avril 1945, rapatriée le 30. Elle a la douleur de perdre son seul frère, Philippe, professeur de lettres engagé dans la Résistance en Bretagne, combattant FFI ; il a été arrêté en avril 1944, déporté de Compiègne à Neuengamme, et est mort du typhus, à Bergen‑Belsen, le 1er mai 1945, après la libération du camp. Elle‑même sera reconnue comme Grande invalide de guerre (à 100%) souffrant de multiples pathologies (vésicule biliaire infectée, rhumatismes, intestins délabrés, asthénie), elle sera aussi multimédaillée au titre de la Résistance intérieure française, et honorée pour s’être investie, quotidiennement, dans la transmission de la mémoire et de l’histoire des Résistances et des Déportations. Dès le mois de Juin 1945, elle est membre du Conseil d’administration de l’Amicale d’Auschwitz et des camps de Haute Silésie, puis de la FNDIRP (Fédération nationale des déportés, internés et résistants patriotes). Parallèlement, elle travaille au Commissariat à l’énergie atomique, avec Frédéric Joliot‑Curie, puis comme assistante dans les Universités de Panthéon‑Sorbonne et Paris–sud/Orsay ; elle s’est mariée en 1948 avec Francis Cohen, dont elle aura trois enfants, deux garçons puis une fille, Isabelle, l’auteure du livre Revenir‑raconter‑Portrait de ma mère au subjectif imparfait. Conjuguant les responsabilités, elle devient présidente de l’Amicale d’Auschwitz en 1950. Elle fut, jusqu’à la fin de son mandat en 1971, un inlassable témoin et un écrivain de la Déportation, coopérant sans relâche, avec son amie Charlotte Delbo, aux recherches précédant la rédaction du livre Le convoi du 24 janvier paru aux Éditions de Minuit, s’adressant aux jeunes et aux professeurs, bataillant contre les révisionnistes et les négationnistes de la Shoah, intraitable dans la demande répétée de procès et de châtiments contre les coupables de crimes contre l’humanité. Elle fut aussi membre des jurys du Concours national de la Résistance et de la Déportation (Éducation nationale) et du prix Marcel Paul (fondé par la FNDIRP) en 1988. Aux dires de tous les membres de sa famille, elle prenait chaque jour en charge la défense des droits et du mieux être de ses camarades déportés, les activités multiformes de l’Amicale (commémorations, bulletin Après Auschwitz, rencontres annuelles et voyages d’étude). Autant dire, comme l’écrit en 1973 Henry Bulawko, son successeur à la tête de l’Amicale, dans Après Auschwitz N°249, qu’elle « aurait pu reprendre ses activités professionnelles, vu la place qu’elle y avait acquise. Sans plus ! mais la solidarité de « là‑bas » devait être préservée et elle s’y est consacrée, gagnant l’attachement et le respect unanimes. |  |