Des femmes dans le bureau de l’enfer
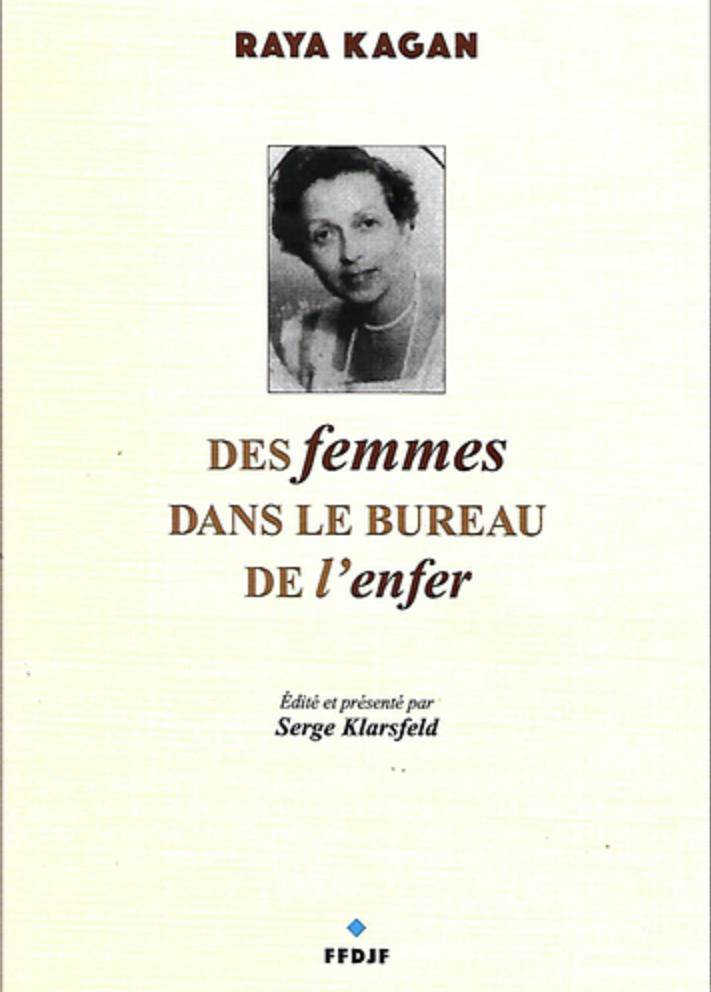
Raya (Raissa) Kagan, née Rapoport, a été déportée de France par le convoi n°3, le 22 juin 1942, le premier qui emmenait des femmes, 66 sur 999 personnes. En mai 1945, elles étaient 6 survivantes dont Claudette Bloch (Kennedy) qui fut très proche de l’Amicale d’Auschwitz, amie personnelle de sa présidente Marie-Élisa Cohen (1950-1992). Dès la fin de la guerre, Raya Kagan est partie vers la Palestine juive où en 1947 elle a publié son témoignage en hébreu aux Éditions Sifriat Hapoalin (la bibliothèque des travailleurs). Celui-ci vient d’être traduit en français (Fabienne Bergmann) et édité par l’entremise de Serge Klarsfeld (Éditions FFDJF, 2020) qui avait repéré l’ouvrage dans les années 1970.
Née en Ukraine en 1910, venue en France en 1937 pour y préparer un doctorat en histoire, Raya est arrêtée le 27 avril 1942, considérée à tort comme membre d’un réseau de résistance communiste. Après un passage par le dépôt de la préfecture de police, elle connaît durant plusieurs semaines le camp des Tournelles (Paris 20e) puis elle est déportée à Auschwitz-Birkenau, le 22 juin 1942. Son convoi ne subit pas de sélection à l’arrivée – celles-ci sont instaurées le mois suivant, durant juillet 1942. Quelque temps après son arrivée, elle est immatriculée et tatouée (matricule 7984).
Femme diplômée, parlant plusieurs langues, elle est repérée par les autorités et devient une « prisonnière de fonction » au service de l’administration du camp, le Standesamt, situé à Auschwitz I. Elle est logée dans un bâtiment imposant, qui relevait antérieurement de l’administration polonaise, renommé le Stabsgebäude, situé à environ deux cents mètres du camp souche.
Le témoignage de Raya Kagan, rédigé dans un langage clair quant à la réalité du camp, et valorisé par cette traduction, est exceptionnel à plus d’un titre. Arrivée en juin 1942, elle évoque la première période du génocide des Juifs à Auschwitz-Birkenau (les arrivées massives avaient commencé en mars, trois mois auparavant) ; également parce qu’elle a traversé l’ensemble de la période génocidaire, jusqu’à l’évacuation de janvier 1945, restant au camp deux ans et demi. Exceptionnel encore, parce que ce témoignage est rédigé rapidement après la fin de la guerre, de sorte que l’on a quelque fois l’impression de lire un journal. Grâce à Raya Kagan, on accède à des moments que l’on connait surtout par les sources administratives allemandes, moins par les témoins. Ainsi, le secteur des femmes dans le camp d’Auschwitz, qui a existé entre mars et août 1942, avant le transfert des femmes vers Birkenau. Surtout, elle donne à voir le fonctionnement de l’administration du centre d’assassinat, depuis le Standesamt où elle est affectée, bureau qui gérait les admissions des femmes et des hommes orientés vers le camp pour le travail forcé, en sursis, ainsi que leurs décès – tandis que, de la majorité des déportés, de toutes celles et tous ceux assassinés par le gaz dès l’arrivée, aucune trace n’était officiellement gardée. Dès le début, au printemps 1940, les actes de décès ont concerné tous les prisonniers entrés au camp, juifs et non juifs ; en revanche, ils n’ont plus été établis pour les Juifs à partir de mars 1943 – époque de l’entrée en fonction des grandes chambres à gaz-crématoire. Le témoignage de Raya Kagan rejoint ici l’histoire des archives du camp, lorsqu’elle précise ce changement dans son travail (p.168). Si les SS ont entrepris de détruire les archives au moment de « l’évacuation », des milliers d’actes de décès ont subsisté, conservés par le Musée d’État d’Auschwitz.
Durant deux ans et demi, Raya connaît essentiellement le camp d’Auschwitz et ses espaces proches, ne restant qu’une semaine à Birkenau, à l’été 1942. Son témoignage qui suit la chronologie cite de très nombreux personnages, parmi les prisonnières et prisonniers mais aussi des membres éminents de la hiérarchie SS, côtoyés au quotidien. Parmi les figures qui ont survécu, il faut citer Claudette Bloch, ou encore des femmes du convoi dit des « 31 000 », du 24 janvier 1943. Raya fait partie d’un groupe très particulier de femmes, privilégiées à plus d’un titre mais néanmoins menacées de mort, qui évoluent en marge des souffrances, dans un lieu stratégique où bat le pouls de l’activité principale, la mise à mort. Son groupe était proche de celui des femmes scientifiques qui furent envoyées à Rajko après être passées également par le Stabsgebäude.
Raya Kagan a été témoin au procès Eichmann le 8 juin 1961. En Israël, elle a mené une carrière au sein du ministère des affaires étrangères. Elle est décédée en 1997.
Isabelle Ernot, Après-Auschwitz, n°355-356, Juillet – Septembre / Octobre – Décembre 2020
