La Maison Zola – Le Musée Dreyfus, à Médan
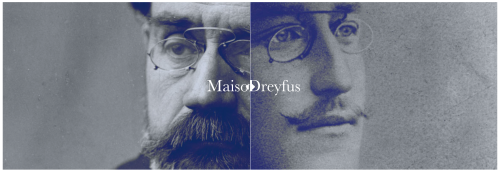
Voulu par Pierre Bergé, propriétaire à travers la fondation qu’il a créée, de la Maison d’Émile Zola à Médan, le Musée Dreyfus y a été inauguré le 26 octobre dernier. C’est l’achèvement d’un travail considérable poursuivi après la mort de Pierre Bergé par Louis Gautier qui lui a succédé à la tête de la fondation1 , et réalisé par l’historien Philippe Oriol devenu directeur scientifique du Musée, avec Anne-Gaëlle Duriez et Mathis Herbette, bénéficiant du plein soutien des familles Zola et Dreyfus représentées respectivement par les héritiers en ligne directe Martine Zola-Leblond et Charles Dreyfus.
Tout le domaine et la demeure célèbres ont connu durant ces années de conception une vaste et très complète restauration, la maison retrouvant son état originel tandis que le musée s’installait dans l’aile ouest, sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, on y suit les combats communs d’Alfred Dreyfus et d’Émile Zola, « deux enfants de la République », tandis qu’à l’étage, une longue coursive s’ouvre sur l’Affaire dans toutes ses dimensions avec une inflexion particulière sur le combat pour la justice. La photographie de la remise de la croix de la légion d’honneur au Capitaine – devenu commandant – Dreyfus, marquant sa réhabilitation judiciaire de juillet 1906, est ainsi présentée en grand format. Elle rappelle qu’en dépit de cette distinction – qu’il aurait reçu tôt ou tard comme brillant officier d’active breveté d’état-major, la réhabilitation militaire n’est pas intervenue, sa reconstitution de carrière étant restée incomplète, le privant des hauts grades auxquels il pouvait aisément prétendre au vu de son prometteur début de carrière. L’accession du capitaine au généralat aurait eu à l’époque un fort retentissement aussi bien civique, patriotique que militaire. La France avait besoin de tels officiers intellectuels, ne mesurant par leur courage et leur liberté, comme le démontra Jean Jaurès en 1911 dans L’Armée nouvelle2. On peut s’interroger sur les conséquences du climat anti-dreyfusard dans l’armée, amenant au départ de bon nombre d’officiers d’active modernistes et républicains comme Dreyfus, et l’échec du haut commandement en 1914. Demandant sa mobilisation dès la déclaration de guerre, le commandant devenu lieutenant-colonel fut cantonné à des fonctions subalternes.
Le choix des documents, la précision des cartels, le parcours muséographique, la scénographie développée, … tout fait sens et se révèle d’une très grande qualité. Incontestablement, ce Musée Dreyfus est une réussite scientifique appelant un succès populaire. Son accueil par la Maison Zola possède une grande pertinence dans la mesure où l’écrivain n’a pas seulement défendu la justice, la vérité comme une certaine idée de la France mais aussi l’homme lui-même, l’humanité que représentaient le Capitaine, sa femme Lucie, son frère Mathieu, ses enfants Jeanne et Pierre, porteurs des mêmes valeurs de courage et d’avenir.
Par une froide et grise journée d’automne traversée des rayons d’un timide soleil, le président de la République Emmanuel Macron est venu inaugurer la Maison et le Musée, s’attardant longuement devant les œuvres exposées, prenant le temps de l’échange et de la confidence avec Martine Leblond-Zola et Charles Dreyfus, puis avec toutes les familles réunies. D’émouvantes prises de vue, dans le jardin de Médan, témoignent de cette rencontre et de cet hommage de la République à ses combattants immémoriaux. La lecture de l’intégralité de la « Lettre à la jeunesse » est venue distraire l’attente d’un important parterre d’invités, patientant sous des tentes d’un blanc immaculé, attentif à l’appel de l’écrivain pour que la jeune génération renonce à toute tentation de haine de race et s’engage au contraire dans une solidarité sans faille pour les persécutés, contre toutes les injustices. Parlant auprès du Grand Rabbin de France Haïm Korsia, le chef de l’État s’est écarté de son discours écrit pour mieux s’adresser à l’assistance et aux journalistes de presse qui n’oublient pas ce qu’ils doivent à l’auteur du « J’accuse… ! ».
Saluant le travail réalisé par les concepteurs du Musée, Emmanuel Macron releva la signification des souffrances et des résistances d’un homme. « Vous redites l’importance de ce destin si particulier, de cet homme qui a subi le pire, l’humiliation, le silence, l’isolement. Rien ne réparera ces humiliations mais ne les aggravons pas en les laissant oubliées, aggravées ou répétées », a-t-il plaidé en évoquant sans les nommer les entrepreneurs de haine et les négateurs de l’histoire d’aujourd’hui. « N’oubliez rien de ces combats passés, car ils disent que le monde dans lequel nous vivons, comme notre pays, comme notre République, ne sont pas des acquis. […] Il y a dans ce musée ce qui est inséparable entre ce qui fait la Nation et ce qui fait la République française : des idéaux, un amour de la langue et ce goût pour la vérité et la justice ». Le président de la République a poursuivi en direction d’Émile Zola et de ses engagements pour la démocratie républicaine :
« Zola, c’est aussi une vie de combat pour lequel il a pris des risques fous, et en particulier l’Affaire Dreyfus, un combat éminemment républicain, consubstantiel à la République », concluant : « Un de ces combats où la République est d’ailleurs devenue pleinement elle-même ».
Vincent Duclert, Après Auschwitz, n°355-356, Juillet – Septembre / Octobre – Décembre 2021
