Le Ghetto intérieur
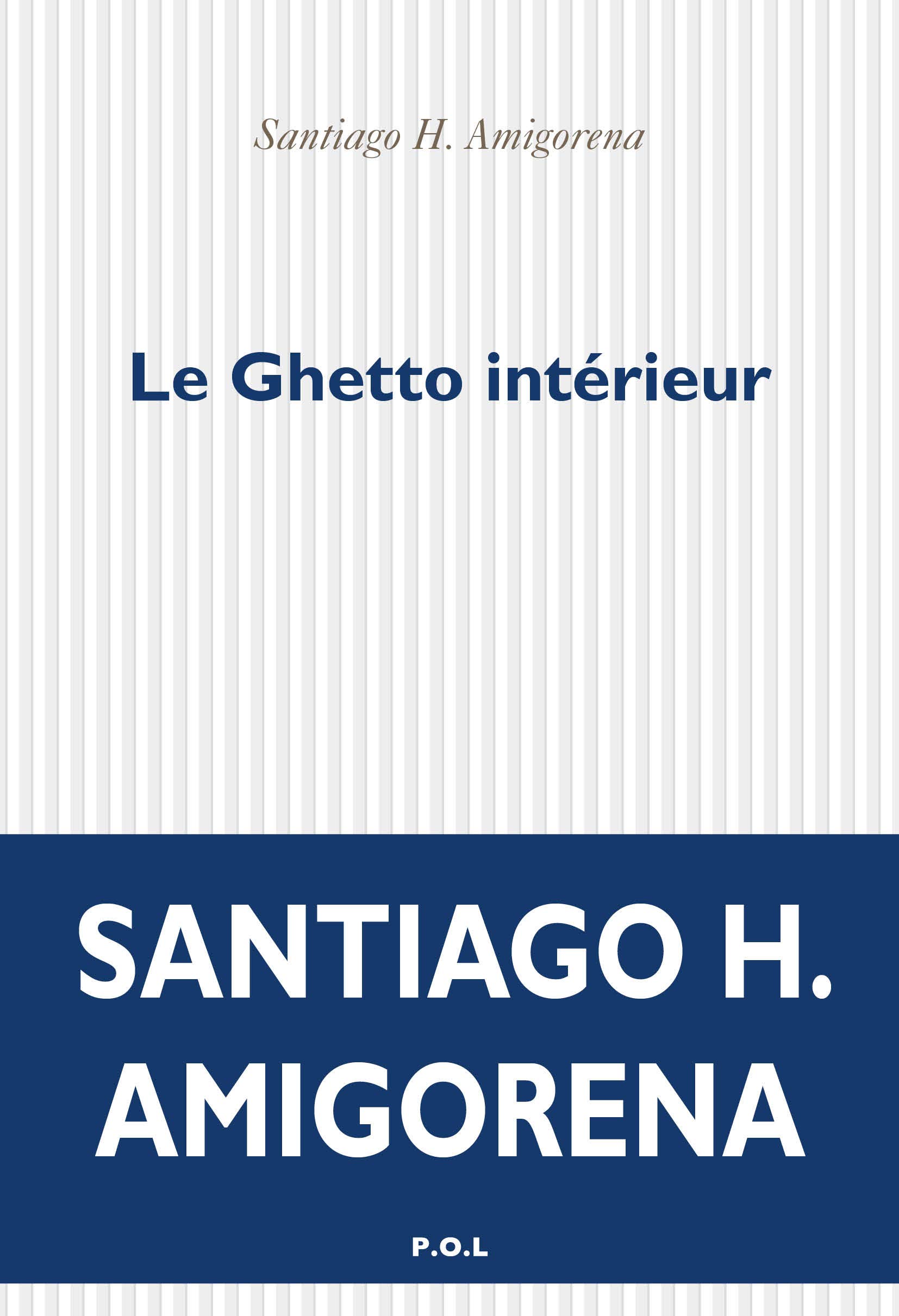
Avec cet ouvrage, l’auteur poursuit son projet romanesque et autobiographique et revient à sa racine inspiratrice.1 Il ouvre une fenêtre sur la biographie de son grand-père Vicente Rosenberg, immigré juif polonais venu s’installer en Argentine dans les années 1930 où l’homme s’est construit rapidement une vie heureuse, familiale et professionnelle. C’est sur ce continent qui ne connaît pas les violences nazies que le génocide des Juifs d’Europe, alors en cours, le rattrape. Nous sommes en 1942 et Vicente Rosenberg, par les dernières lettres à lui adressées par sa mère, comprend la perte des siens. Des rets invisibles viennent le rattacher à l’histoire de sa famille et à ses racines. La douleur de la perte chemine avec une profonde culpabilité, celle de n’avoir pas fait ce qu’il fallait pour faire venir toute la famille en Argentine et particulièrement sa mère. Lorsque les liens avec Varsovie s’éteignent, le fils s’enfonce dans un silence profond, se mure en lui-même, devenant une image du ghetto. Ce choix – l’homme est conscient – n’est accompagné d’aucune explication ; imposé aux proches, à son épouse, ses enfants, il est pour eux une souffrance. L’homme qui marchait vers son propre anéantissement est en définitive sauvé par leur amour.
Le mutisme au centre de l’ouvrage induit un chemin narratif complexe sur le plan littéraire, accompagné dès lors par un récit historique du massacre génocidaire. L’ouvrage rappelle avec intérêt la destinée de migrants juifs qui avaient quitté le continent européen avant la guerre, épargnés par la Shoah mais dont c’est aussi l’histoire.
Isabelle Ernot, Après-Auschwitz, n°355-356, Juillet-Septembre / Octobre-Décembre 2020
