Les enfants de Cadillac
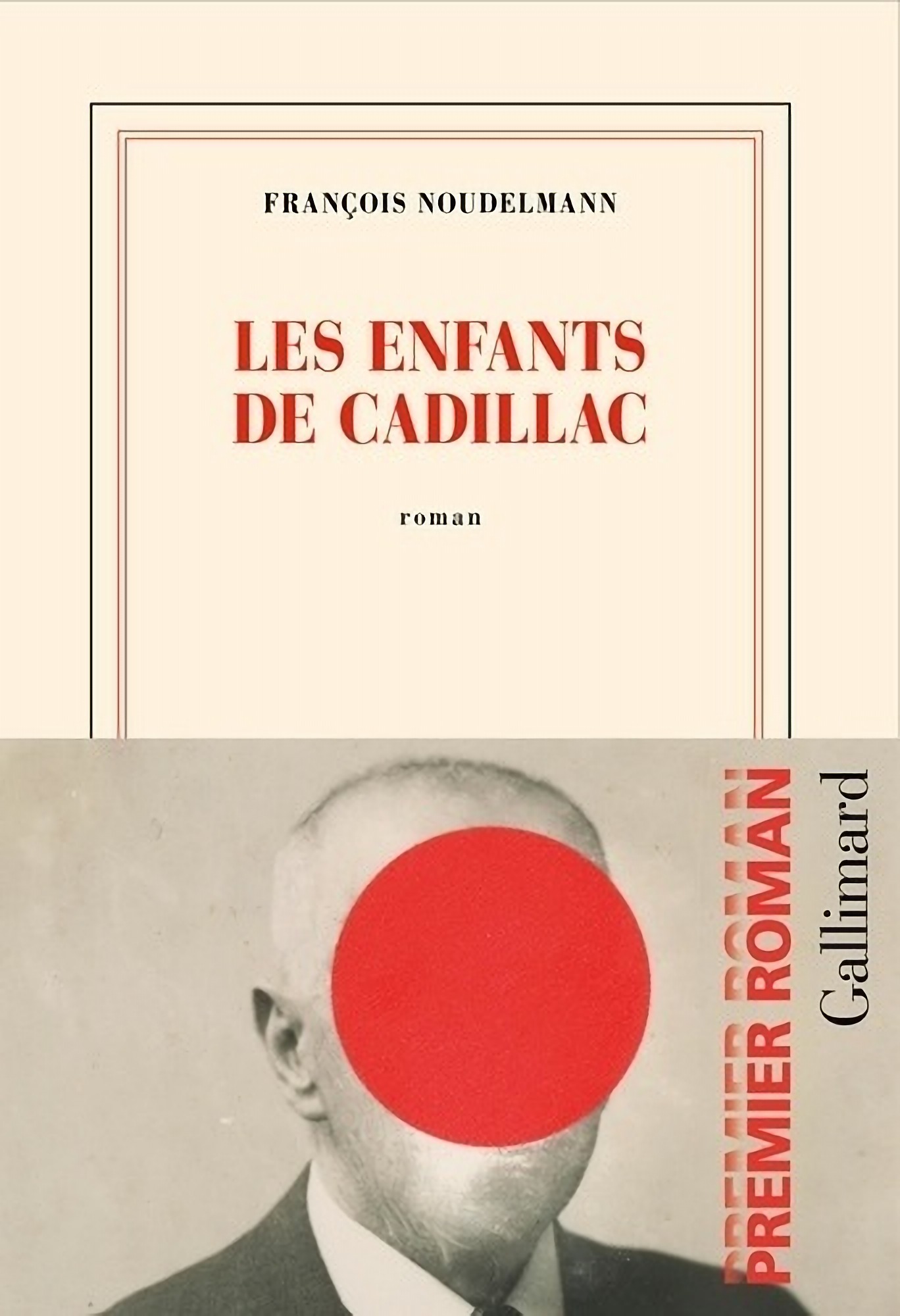
Trois générations et trois pronoms personnels pour résumer un siècle, le XXème en ces années les plus furieuses, et raconter l’entrée en « francité » d’un grand- père, d’un père et du fils qui écrit Les Enfants de Cadillac, roman paru en ce mois d’août 2021.
Le terme de roman doit être pris comme un mode de classement, aussi bien dans les librairies que dans une actualité, celle des prix littéraires d’automne. Les Enfants de Cadillac figure déjà sur la liste des Goncourt, seul premier roman en lice, mais jusqu’à quand ? Quand paraitront ces lignes, le prix aura été remis. On oubliera alors la catégorie pour s’attacher à ce que raconte François, le bien nommé, de Haïm, son grand-père gazé sur le front pendant la guerre de 14-18 et d’Albert, son père, prisonnier en Pologne et Allemagne entre 1940 et 1945.
Haïm est né en Lituanie en 1891. Il a fui cette terre alors russe, dans laquelle misère et pogrom formaient un duo très convenu. En 1911, arrivé à Paris, cet analphabète ébloui par Hugo, Zola et la liberté s’engage comme soldat afin d’acquérir la nationalité française. Il n’a pas le temps d’être dégagé des obligations militaires. Il se retrouve dans les tranchées. C’est à peine s’il a eu le temps de se marier avant la guerre et d’avoir un fils. Grièvement blessé, il est interné dans divers hôpitaux psychiatriques. Le dernier en date est celui de Cadillac, dans la Gironde, et il subit le sort qu’a décidé le régime de Vichy pour ses « malades mentaux » : les exterminer « en douceur », par la faim, le froid, les sévices et autres maltraitances. Il meurt en 1941 et son corps est jeté dans une fosse commune.
Albert, son fils, veut aussi être français, à sa façon : en internationaliste. Dès sa jeunesse, il milite à gauche, soutenant tous les partis et mouvements luttant pour le peuple, et contre le fascisme qui vient. En 1937, il doit faire son service militaire. Il n’est pas démobilisé en 1940 quand son régiment subit la débâcle. Il est fait prisonnier et connaitra les stalags, les camps réservés aux fortes têtes, le travail forcé, puis, lors de la défaite du Reich, le déferlement des troupes soviétiques pas toujours bien disposées à l’égard des habitants. L’armée nazie et ses auxiliaires n’avaient pas non plus été très bien disposés à l’égard des populations russes ou ukrainiennes.
Il, tu, je : chaque partie du roman commence avec un pronom. Haïm est ce « il » presque anonyme, bien méconnu, à peine identifié par les registres, les archives et un lieu pour se recueillir. Tu, c’est Albert, ce père si proche, si éloigné qui a vécu une incroyable épopée dans la Silésie et l’Allemagne en guerre et en ruine. Albert s’est suicidé un 16 juillet comme s’il fermait une boucle qu’il avait ouverte sans le savoir vraiment.
Je, enfin, c’est l’auteur narrateur. Il a tout rassemblé et il fait le bilan, même si, comme il l’écrit en incipit, « La recherche des ancêtres m’a toujours paru assommante, et même douteuse. » La troisième partie du livre montre bien que la vraie recherche au fond, c’est sur lui-même qu’il la conduit. Quels choix a-t-il faits, connaissant ceux qui l’avaient précédé ? Quel français ce François est-il devenu ? Quel héritage est le sien ?
Le livre est passionnant de bout en bout, avec une sorte de progression. Haïm illustre la terrible capacité qu’une patrie a à oublier, à délaisser ceux qui se sont sacrifiés pour elle. Les exemples ne manquent pas et un tirailleur sénégalais, un goumier marocain ou un harki algérien pourraient raconter ce que Haïm a connu. Noudelmann s’en tient à cette histoire dont il possède des bribes et, par éclats, il décrit une nation ingrate et un homme abandonné par les siens. L’émotion est là, suggérée par une écriture sans pathos, sans effet, au plus près de ce qu’a vécu ce pauvre homme. La fin du roman, dans le cimetière de Cadillac où enfin Haïm Noudelmann est nommé est bouleversante.
Albert ressemble quant à lui à ces jeunes qui ont rejoint la M.O.I. ou la France libre. Il n’en a pas eu le temps, fait prisonnier trop tôt. Ses tentatives d’évasion ont toutes échoué et on se demande comment il a pu échapper au peloton d’exécution. Il a pris très tôt le prénom de Philippe, plus « français » (oh combien en 1940 !) qu’Albert, et il a caché autant qu’il le pouvait son identité juive. Pas toujours facile, surtout quand on est circoncis et donc aisément identifiable pour un officier nazi. Albert / Philippe est un combattant. Il ne renonce jamais à se battre pour survivre. Il croit en l’amitié, et celle de ses compagnons, dans certains moments difficiles, est plus précieuse que tout. On ne compte pas les épisodes qui pourraient donner lieu à une série à suspense. Ce père est un héros et malgré sa surdité liée à une blessure lors d’un bombardement, il affronte toutes les épreuves.
Et puis soudain, quelque chose se brise : il est rentré de la guerre, il a subi les pires violences, a failli mourir cent fois mais personne ne veut l’entendre. Les épreuves ne sont pas celles de Primo Levi ou de Simone Veil, la surdité des Parisiens est la même, y compris dans sa propre famille. Heureusement, il aura un fils, François, et il pourra lui raconter, enregistrant sur des cassettes audio ce qu’il a vécu et jamais raconté à personne. Il s’en était détaché, ne lisait jamais rien qui concernât la guerre ou les camps, semblant éloigné de ce passé. Du moins jusqu’à un certain 16 juillet, quand il sort le pistolet.
Vient donc le temps de la réflexion et c’est le moment de l’auteur-narrateur. Il fait son chemin de façon singulière, élevé par ce père solitaire (mais dont la vie amoureuse est très remplie) qui lui lit des histoires, chaque soir, et lui donne ainsi le goût de la lecture que l’école était incapable de lui transmettre. François est un « mauvais élève »… qui réussira l’agrégation de Lettres et obtiendra un doctorat en philosophie. Il milite un temps à l’extrême-gauche, soutient les groupes pro-palestiniens… et passe quelques mois dans un kibboutz.
Il n’a pas de vraie famille, et se constitue des familles d’élection. Sa mère s’est remariée avec un grand bourgeois de province et quand il la voit, il s’adapte aux codes des lieux et des gens. De même avec les femmes que son père fréquente et grâce à qui il ne se sent appartenir à aucun milieu en particulier. Il éprouve comme son père avant la guerre un désir universaliste mais une forme d’intranquillité ne le quitte pas, synonyme selon lui de judéité. Un jour de 2008, le passage sous ses fenêtres d’une manifestation hostile à Israël alors en guerre à Gaza provoque un choc. Le cri de Mort aux juifs repris par la foule lui fait sentir combien la haine ancestrale reste vive. La conclusion est claire : entre se vouloir libre, sans héritage, et se tenir pour un descendant, l’auteur a longtemps cru possible de n’hériter de rien. Sans être un descendant, il se sent plus proche de cet état, désormais. Même s’il préfère l’expression « tomber sur » que « venir de » pour tracer un chemin dans l’existence.
Norbert Czarny, Après Auschwitz, n°355-356, Juillet – Septembre / Octobre – Décembre 2021
