Messagers du désastre
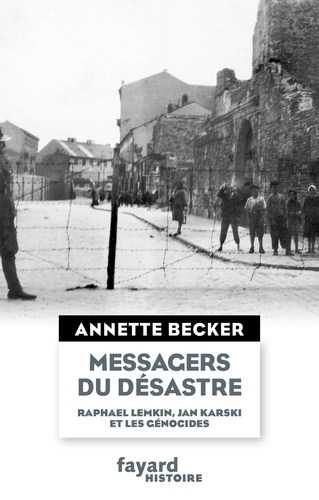
Il y a quelque chose de plus effrayant que le messager qui ne peut faire passer son message. C’est quand il l’a fait passer et que rien n’a changé.
ELIE WIESEL, P.228
Annette Becker cite là le discours d’Elie Wiesel lors de l’inauguration du Musée Mémorial de l’Holocauste de Washington en 2005. A travers le parcours de deux hommes, Polonais, deux « messagers », l’un Juif, Raphael Lemkin (1900-1959), l’autre catholique, Jan Karski né Kozielewski (1914-2000), Annette Becker, sollicitant de multiples sources, s’attache à approcher « le désastre », l’événement que constitue le génocide à travers son écho, d’abord dans le temps de son « exécution », l’incapacité première de la société occidentale à appréhender, à « entendre » ce crime commis en son sein, puis après la guerre et jusqu’à aujourd’hui, un écho saisi notamment à travers le domaine juridique et la question de la qualification du crime.
La question du pourquoi cette « information vive » bien que connue ne fut pas crue ou bien ne déclencha quasiment aucune réaction des autorités, sous-tend l’ouvrage. Entre 1939 et 1941-1942, témoins des violences extrêmes perpétrées à l’encontre des Juifs par les nazis, de leur caractère systématique, les deux hommes, chacun dans leur sphère, perçoivent l’intentionnalité d’un assassinat à grande échelle des Juifs, ils saisissent la mise en œuvre d’une politique d’extermination.
Dans l’est de la Pologne, Raphael Lemkin parvient à échapper au processus d’assassinat. Il gagne la Suède puis – mais difficilement – les Etats-Unis, où il arrive en avril 1943. Jan Karski, quant à lui, courrier de la résistance polonaise, voit de ses yeux le processus qui conduit à l’assassinat, à Varsovie et dans la région de Belzec. Si l’essentiel de sa mission envers le gouvernement polonais en exil à Londres, concerne la situation de son pays, ses informations portent aussi sur les violences spécifiques dont est victime la population juive. Ses informations qui parviennent à Londres à l’automne 1942 – lui-même y arrive en novembre – recoupées avec d’autres provenant de canaux parallèles, sont à l’origine de la déclaration commune des Alliés en décembre 1942, par laquelle ils disent officiellement leur connaissance de l’assassinat de masse des Juifs alors en cours en Pologne.
Jan Karski gagne à son tour les Etats-Unis en 1943.
Chacun de leur côté, ces deux hommes informent les autorités, dénoncent le crime, écrivent ; leurs dires sont relayés par des journalistes, des écrivains. Et pourtant, rien ne se passe. Confrontés à l’attentisme et au silence, « à ce déni » (p.147), chacun à leur manière, ils dénoncent cette situation comme une attitude de complicité. Le président Roosevelt et son administration apparaissant particulièrement concernés.
Le croisement de sources, nombreuses et diverses – archives privées et publiques, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis (notamment Mémorial de l’Holocauste à Washington), en Israël (Mémorial Yad Vashem), en France (Mémorial de la Shoah), en Pologne- dessine ce gouffre que représente, devant l’histoire humaine, l’assassinat de masse des Juifs d’Europe au moment où il a lieu. Annette Becker cite les Mémoires du messager Jan Karski qui rappelle les paroles de deux Juifs qui l’ont guidé dans le ghetto de Varsovie pour faire de lui un témoin : « Les Allemands ne cherchent pas à faire de nous des esclaves comme ils le font des Polonais ou d’autres peuples conquis. Ce qu’ils veulent, c’est exterminer tous les Juifs, la différence est là. […] Et c’est cela que le monde ne comprend pas. On ne parvient pas à l’expliquer. Eux là-bas, à Londres ou Washington ou New York, ils croient certainement que les Juifs exagèrent, qu’ils sont hystériques.» La spécificité et l’ampleur du crime apparaissent en définitive comme des causes majeures.
Ce sont aussi ces caractéristiques qui donnent prise au doute sur la réalité du crime. Spécialiste également de la Première Guerre mondiale, Annette Becker montre comment le rapprochement, par les contemporains, des informations sur les violences extrêmes perpétrées par les nazis avec celles qui se sont déroulées durant la Première, a pu jouer comme un élément de désinformation. De vraies atrocités commises par les Allemands en Belgique en 1914 avaient fini par passer pour de la propagande anti-allemande. Les atrocités nazies ont pu être considérées de même : la cruauté rapportée qui dépassait l’entendement ne pouvait que relever de l’imagination ou de la manipulation.
Il fallait donc bien « qualifier », qu’un mot dise enfin cette impossible réalité. Annette Becker retrace la complexité de la genèse du terme « génocide » créé par Raphaël Lemkin, qui répondait en quelque sorte à l’expression utilisée en 1942 par Winston Churchill du « crime sans nom ». Formulé en 1943 (dans son ouvrage Axis Rules in Occupied Europe – Le régime de l’Axe dans l’Europe occupée), le terme est forgé par l’association d’une racine grecque (genos : peuple) et d’une autre latine (occidere: tuer). Jusqu’à sa disparition précoce en 1959, Raphael Lemkin se consacre à le faire admettre et adopter par les plus hautes instances. Non sans difficulté.
La guerre a fait de lui un survivant. Juif, originaire de la région de Lemberg, il réussit à échapper à la mort en fuyant vers les Etats baltes puis la Scandinavie. Ce ne sera pas le cas de ses parents et d’une partie de sa famille. Juriste de formation, une fois aux Etats-Unis, il déploie un engagement total. « Dans la forêt, j’ai déclaré aux morts et aux vivants que si je survivais je vouerais exclusivement le reste de la vie à la mise hors la loi du génocide. […] Deux croyances nées de la forêt : 1 – La loi doit régner pour que plus rien ne soit détruit. 2 – Foi en la victoire ultime de la construction sur la destruction. ». Il s’agit bien là d’un « témoignage », d’un engagement de survivant qui regarde vers le futur de l’Humanité.
Il mène sa lutte dans le domaine du droit. Son travail et son histoire établissent une filiation entre l’assassinat de masse subi par les Arméniens et celui des Juifs. Durant l’entre-deux, en effet, il avait d’ores et déjà réfléchi à la question de la qualification de la destruction du peuple arménien – dans ses dimensions plurielles – dont il est contemporain. « Son » concept devait rendre compte d’un assassinat global.
A Nuremberg, à son grand désarroi, le terme n’est pas retenu comme chef d’accusation par le Tribunal, qui lui préfère la notion de « crime contre l’humanité » défendue par un autre Juif de la région de Lemberg, émigré en Grande-Bretagne, Hersch Lauterpacht. Il faut attendre 1948. Le terme est alors entériné par l’adoption de la Convention pour la prévention et la répression du crime de Génocide (9 décembre, parallèlement à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, adoptée le 10 décembre).
Dans le dernier chapitre intitulé « Arméniens, Juifs, Tutsis du Rwanda », Annette Becker met en évidence l’importance du concept quant au processus de Justice, dans le combat pour la reconnaissance du génocide antérieur des Arméniens, toujours nié par le pays-auteur, et pour celui postérieur des Tutsis ainsi que son rôle dans le processus de résilience, à commencer par Raphael Lemkin lui-même :
« l’invention du terme de génocide lui a permis de passer de son deuil personnel, à l’universel » (p.238). Œuvre de juriste, œuvre de survivant, les derniers mots au sujet du « désastre » lui reviennent : « J’ai transformé mon désastre personnel en une force morale. […] N’était-ce pas la meilleure forme de gratitude que de faire un « pacte de génocide » comme une épitaphe sur la tombe symbolique de ma mère et d’affirmer qu’elle et des millions d’être humains n’étaient pas morts en vain ? […] La lutte pour la reconnaissance du concept de génocide serait un réconfort dans mon chagrin ». (p.238)
Isabelle Ernot, Après Auschwitz, n° 345, mars 2018
