Par instants, la vie n’est pas sûre
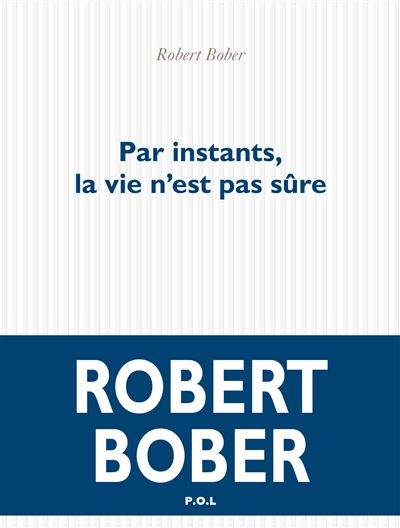
En bonne compagnie
On se sent très vite en compagnie, lorsqu’on lit Robert Bober. On entre dans les pages de ses livres comme on ferait une promenade avec lui. Pourquoi pas du côté de la Butte aux cailles, quartier dans lequel il est né et où il situe Berg et Beck, l’un de ses romans. Mais cette île du 13ème arrondissement n’est pas le seul lieu que l’on arpente en lisant Par instants, la vie n’est pas sûre : inévitablement, on retrouve Perec, Belleville, la rue Vilin, Ellis Island, d’autres endroits de Paris, dont cette rue Dieu qui, contrairement à la rue Jonas dont on apprend qu’il fut un prophète, n’a pas de commentaire. Mais cette lettre est aussi remplie de livres. Certes, on ne marche pas dans les livres, mais on y déambule. Lentement. Bober lit très lentement, il souligne des mots, en recopie beaucoup sur des post-it collés sur ses étagères. Ce livre fourmille de phrases que l’on voudrait recopier ; autant recopier tout le livre, ou presque.
Par instants, la vie n’est pas sûre est une longue lettre que Bober adresse à Pierre Dumayet, son ami, complice, compagnon de travail, décédé en 2011. Le long titre est tiré d’un des récits de Dumayet. Bober parle au présent, et rappelle à son ami les moments, les romans, les souvenirs et rencontres qu’ils ont partagés ensemble. L’un filmait, l’autre interrogeait, la pipe figée entre les lèvres, acceptant les silences, les attentes, ne cherchant pas à toute force la révélation, comme le font les journalistes aujourd’hui. Qui n’a jamais vu « Lecture pour tous », ou « Lire c’est vivre », deux émissions très différentes l’une de l’autre, mais marquée du sceau de ces premiers hommes de
télévision qu’étaient Desgraupes ou Dumayet ne sait pas ce qu’est l’intelligence en action. Je garde le souvenir du rire de Queneau, esquivant ainsi les questions trop personnelles, celui des longs blancs de Marguerite Duras. C’était autre chose que de voir chaque mercredi un bonimenteur soulever un livre comme on présente un nouveau produit pour nettoyer les plaques vitro-céramique. Mais je m’égare et exagère puisque le mercredi, je ne regarde pas la télévision. Revenons à ce beau livre, ce livre d’amitié, de pudeur et d’émotion. Ce livre qui parfois digresse parce que l’essentiel ne se voit qu’au détour.
Bober a été un enfant caché. A un moment, il cite un propos de son ami Jean-Claude Grumberg : « plus je vieillis, plus je me sens fils de déporté ». Je m’arrête sur cette phrase, elle m’émeut, me parle comme peu. On pourrait dire, plus le temps passe, plus il nous éloigne de l’épreuve que les nôtres ont vécue, plus il nous rapproche d’eux. Sans doute ne faut-il pas les laisser, ces déportés maintenant morts, ou en passe de décéder (je n’ai pas envie de dire « disparaître ».) Et d’autant plus en ce moment, quand la vie n’est pas sûre du tout. Bober y fait allusion, et rappelle un film qu’il voulait réaliser pour la télévision avec Grumberg, Lévy, cycles et accessoires, d’après une nouvelle de Jean-Richard Bloch.
Il y était question d’une foule antisémite, hurlant sa haine au moment de l’Affaire Dreyfus, dans un village breton. Le directeur des antennes, à l’époque, Yvon Bourges, avait refusé de financer le film. Oublions-le. Mais pas l’anecdote ni la photo qui en témoigne, page 286 du livre : nos deux artistes posent devant un panneau d’entrée dans un village : Belz. Pas loin de Lorient. Ce même nom que porte le Shtetl d’une fameuse chanson yiddish, épicentre du hassidisme, aussi.
Venons-y : le yiddish, le hassidisme, le monde disparu que d’aucuns essaient de faire renaitre. Bober évoque l’une des premières émissions réalisées avec Dumayet, autour du hassidisme, en compagnon du rabbin Safran. Des années plus tard, ils ont lu Gog et Magog, de Martin Buber. Les « Cours » existent toujours, à New York, Jérusalem ou Bnei Brak. Pour le yiddish, c’est moins évident, même si un écrivain comme Erri de Luca en parle, le traduit, diffuse la pensée. Et puis des traducteurs ont œuvré, comme Batia Baum et Rachel Ertel, pour faire connaître le monde désormais disparu qu’il incarnait. Dans l’autre sens, du français au yiddish, il s’est trouvé un Litvine pour traduire la poésie française, de Louise Labbé à Queneau. La bibliothèque Medem, ses 20 000 volumes que Bober montre à Erri de Luca sont là aussi pour rappeler combien ces pauvres immigrants, venus de Pologne, de Russie et d’ailleurs avaient soif de connaissance. Il semble même que L’assommoir en yiddish soit plus puissant encore que dans l’écriture de Zola.
Par instants, la vie n’est pas sûre est un hommage, ou comme on dit aussi, un tombeau. Celui de P.O.L., ce Paul mort accidentellement, qui avait publié Perec (après Maurice Nadeau) et incité Bober à écrire. Pas seulement les huit pages manuscrites
que le documentariste lui avait envoyées, non, plus. Il venait de commencer un roman. Sept ans et quelques chapitres plus tard paraissait Quoi de neuf sur la guerre ? roman qui valut à son auteur de très nombreuses lettres, des témoignages souvent, auxquels il ne savait pas toujours quoi répondre. Et Perec. L’ami, le frère ou presque. J’ai parlé des silences, il faudrait dire les blancs, les vides, l’absence. Bober cite une superbe phrase tirée de W Un souvenir d’enfance, autour des gestes quotidiens que l’on fait en famille, d’une mère qu’il aurait voulu voir chaque soir. Il en est d’autres, des phrases, des visages, des êtres.
Bober cite une émission avec le cardinal Lustiger, né en Pologne et resté enfant, sous son habit de prêtre. Il évoque une rencontre entre Danielle Darrieux et Simone Veil, elle aussi redevenue enfant le temps de cette rencontre. Il ne peut pas ne pas nommer Max Ophüls, qui ouvre son Vienne avant la nuit, documentaire et album, consacrés à sa famille rejetée à Ellis Island et provisoirement installée à Leopoldstadt, le quartier juif de la capitale autrichienne.
Des noms, comme dans les récits d’Eric Vuillard, comme sur les plaques dédiées aux morts de Charlie, à ceux de L’affiche rouge, des mots aussi, comme ceux que Serge Lask, enfant de déportés lui aussi, écrivait et peignait avec obstination sur ses toiles, dans le plus grand des silences.
C’est tout cela Par instants, la vie n’est pas sûre. Et par instants, la vie devient bien meilleure, et plus apaisée.
Norbert Czarny, Après-Auschwitz, n°355-356, Juillet-Septembre / Octobre-Décembre 2020
