Planète Tenenbaum, A propos d’Eduardo Halfon
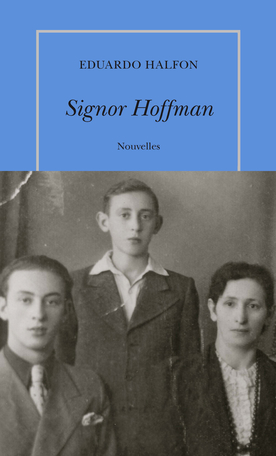
Récit après récit, Eduardo Halfon assemble les pièces d’un puzzle familial. Comme chez un autre célèbre romancier, on peut parler de deux côtés : celui de Lodz, celui de Beyrouth. Avant d’évoquer celui de Lodz, bref arrêt sur le côté de Beyrouth : le grand-père Halfon est un juif libanais, qui a quitté sa ville natale en 1917, avant la naissance officielle du pays. Son passeport est syrien et l’essentiel de son existence s’est déroulé au Guatemala. On lit son histoire dans Cancion, paru en janvier 2021. Pays natal de l’auteur, le Guatemala est l’un des décors importants de l’œuvre. On le voit dans Deuils (2017) et dans certaines nouvelles de Signor Hoffman (2015).
Mais le côté maternel, incarné par ce Léon Tenenbaum né à Lodz constitue le cœur de l’œuvre. Ou pour le dire autrement il a son soleil : Le boxeur polonais. Deux nouvelles, « Le boxeur polonais » et « Allocution de Povoa », parues en 2014 en français sont celles autour de quoi tourneront ces petites planètes que constituent Monastère et deux nouvelles de Signor Hoffman : « Sable blanc, pierre noire » et « Oh ghetto mon amour ». La figure centrale est Léon Tenenbaum, matricule 69752 à Auschwitz.
Cette histoire de numéro, on la retrouve dans une page de Un père étranger, d’Eduardo Berti (La Contre-Allée, 2021). Elle permet à un certain Miguel d’entrer sans payer dans un bal, à Buenos-Aires). Mais évitons les digressions et les parenthèses.
On n’évitera pas, en revanche, de parler de fausses pistes : le boxeur polonais ne met jamais en scène un Noah Klieger méconnu ou oublié, et Monastère ne se déroule nullement dans ce lieu de foi et de prière à l’écart du monde et du temps. Quant à Eduardo Halfon, ils sont deux : il y a l’auteur, ingénieur diplômé, père d’un petit Léo (Halfon, boy, 2019) et il y a un narrateur personnage qui aurait voyagé, été séduit par une certaine Tamara, israélienne, ou Aiko, japonaise et bien malin qui saura lequel de ces Halfon traverse ces pages et cette vie. Quel plaisir, en un temps rempli de confessions, témoignages, récits de vie et autres révélations ! L’œuvre de Halfon navigue entre le réel et la fiction et le narrateur se déguise, puisant dans la réserve des habits et des passeports, comme il l’explique dans Cancion. Il passe bien des frontières et doit présenter des papiers d’identité plus qu’à son tour.
Mais, même déguisé, nul n’échappe au réel, et la Shoah, les lieux dans lesquels elle s’est déroulée, est aussi puissante que l’est le cadre guatémaltèque dans lequel se déplace Halfon : les Etats-uniens exploitent les richesses, les puissants maltraitent les paysans, souvent d’origine indienne, les paramilitaires massacrent. La dictature, ses alliés et ses sbires tiennent le pouvoir sans fléchir.
Le boxeur polonais pourrait être appelé le conte de la transmission. Léon Tenenbaum, au soir de son existence confie à son petit-fils Eduardo ce qu’il a vécu. Il le fait par un récit. Arrêté lors d’une partie de dominos avec ses amis et sa fiancée, dans le ghetto de Lodz, il est d’abord envoyé vers Sachsenhausen. Et de là à Auschwitz, dans le bloc 11, celui dévolu aux condamnés à mort. Le temps d’une nuit, il écoute un détenu lui dire comment aborder le procès que les nazis lui infligeront. Ce détenu, un juif polonais natif de Lodz comme lui, explique quoi dire, et quoi taire. Léon échappe à la mort.
Nous ne saurons pas ce qui s’est dit cette nuit-là, ni ce qu’est devenu ce « boxeur polonais », pas du tout boxeur, et assez peu polonais. Le silence, ou l’ellipse, est l’un des fondements de l’œuvre. Surtout quand ce qu’on apprend n’est qu’une version des faits, et que dans un journal guatémaltèque, le grand-père en donne une toute autre de sa survie à Auschwitz. Raconter c’est être Shéhérazade, écrire est œuvre de prestidigitateur. Halfon fait apparaître et disparaître ou fait surgir, sans qu’on s’y attende. Restent des éléments présents de livre en livre.
Un ton pour commencer. Sur fond de catastrophes, de crimes, d’horreurs tel que le siècle passé en a distillé, le pathos serait indécent. On sourit très souvent. Les détails détonnent ou détonent. Ainsi, dans Signor Hoffman, lorsqu’Eduardo traverse Varsovie dans sa doudoune rose, et plus encore quand il visite l’appartement qui fut celui de Léon et qu’habite désormais une jeune femme blonde, plutôt avenante. Il se rend aux toilettes et découvre un lot de cassettes vidéo la montrant. Le contraste entre la mémoire dont les lieux sont chargés et les activités de sa locataire au profil singulier crée l’indispensable distance.
Il faut aussi du rituel : petit-fils et grand-père (surnommé Oitze, en yiddish) partagent deux doigts de whisky. Cette complicité amorce la parole. De même, madame Maroszek, dans « Oh ghetto mon amour » écrit de longues lettres manuscrites sur du papier récupéré dans les grands hôtels de Lodz. Elle a besoin du geste, des objets qui l’accompagnent pour revenir dans ce passé qui la liait à Léon. On lira pourquoi dans la dernière page de la nouvelle.
Comme ceux de Daniel Mendelsohn les récits de Halfon, jouent du retour en arrière et forment des boucles : dans le Boxeur polonais, le 69752 apparaît au début et à la fin. Le narrateur l’a découvert enfant et « Oitze » lui faisait croire qu’il avait tatoué son numéro de téléphone pour ne pas l’oublier. A la fin, l’adulte sait tout : « Une fois de plus, je contemplai le numéro de mon grand-père 69752, tatoué un matin d’hiver de l’année 42, par un jeune juif, à Auschwitz. J’essayai de voir le visage du boxeur polonais, ses poings, l’impact de la balle qui aurait traversé sa nuque, d’entendre ses mots en polonais qui avaient sauvé la vie de mon grand-père, mais je ne voyais qu’une file ininterrompue d’individus, tout nus, tout pâles, tout maigres, pleurant et récitant le kaddish dans un silence absolu, tous fidèles d’une religion dont la foi est fondée sur des numéros et attendant en rang de devenir eux-mêmes un numéro. »
Il faut ensuite le refus apparent du grand-père à ce qu’Eduardo aille enquêter en Pologne. Ce refus très claire- ment indiqué dans Monastère et Signor Hoffman se marque dans Le boxeur polonais par celui de prononcer un mot en polonais. Partir est comme dans les contes de fées une transgression indispensable pour que le récit se développe. Avant de donner à son petit-fils les indications utiles pour se repérer, Léon Tenenbaum résiste, s’emporte : il ne veut plus rien avoir affaire avec la Pologne. Ce n’est pour lui hier comme aujourd’hui qu’une terre hostile, un pays antisémite. Près de mourir, il donne pourtant à Eduardo les adresses, précise quel immeuble de Lodz il a habité. Tout cela sur un bout de papier jaune qui revient d’un récit l’autre : « C’était une procuration. Un pouvoir. Un ordre. Un itinéraire. Une feuille de route. Des coordonnées sur la carte familiale cachée et accidentée. C’était enfin une prière. Sa dernière prière. Là, sur ce papier jaune plié, ses ultimes gribouillis de sa propre main que maintenant – debout dans l’aéroport de Varsovie – je serrais comme un talisman, se trouvaient les axes de l’histoire de mon grand-père, une histoire qui d’une certaine façon, était aussi la mienne. Finalement notre histoire est notre seul patrimoine. » Le récit du grand-père a donc incité Eduardo à partir vers les lieux : Auschwitz et Lodz, principalement.
Rien cependant ne se produit de façon linéaire, l’errance s’impose. Pour vivre et écrire, il faut compter avec le Temps, et retarder le moment fait partie du bagage du bon conteur. Entre autres. On ne peut écrire n’importe comment, comme ça vient (à moins de se nommer Stendhal, et ce n’est pas n’importe comment). Amener la réalité à la littérature, écrit l’auteur en substance dans « Allocution de Povoa » qui accompagne « Le boxeur polonais », ne va pas de soi :
« […] Comment la raconter ? Depuis quel point de vue ? Par où commencer ? » Halfon ne répond pas directement. La digression est nécessaire voire indispensable. Dans « Sable blanc, pierre noire », il est question d’un voyage cahotique vers le Belize. Le narrateur est en panne, le passage de la frontière se déroule de façon pénible, son passeport est périmé et il doit en exhiber un autre, espagnol. Et puis au lendemain de ces épreuves, au Belize, il remarque à l’auriculaire d’un officier de l’immigration une bague, surmontée d’une pierre noire. Elle ressemble à celle que possédait son grand-père désormais mort, bague de peu de valeur achetée à Harlem en 1945, et volée, des années plus tard, dans un coffre-fort familial au Guatemala. Le narrateur se persuade qu’elle est au doigt de l’officier. Qu’importe la vérité : c’est pour lui celle dans laquelle « se reflétaient à la perfection le visage des parents exterminés de mon grand-père […] dans laquelle […] « on pouvait encore entendre le murmure de toutes ces voix, de tant de voix, entonnant en chœur la prière des morts. »
Il faut accepter d’errer, de se perdre, en apparence, pour arriver. Il faut accepter les incidentes, les coqs-à-l’âne, les récits qui n’ont pas de rapport avec la trame principale. Dans Monastère, le narrateur raconte une série d’histoires toutes liées à la survie de Juifs pendant la guerre, toutes liées au déguisement, la fausse identité. La plus puissante est la dernière, celle d’un garçon déguisé en fillette catholique et vivant parmi des religieuses. Il garde son poing gauche serré. A l’intérieur, caché, il y a son nom véritable, son nom juif. Lequel s’efface, au bout de semaines dans ce monastère. Celui qui a vécu cette épreuve l’a racontée au narrateur, qui la relate à son tour à Tamara, une jeune israélienne au charme de qui il n’est pas indifférent. Il conclut : « Il a nié son judaïsme et nié sa virilité, et c’est ce qui l’a sauvé ai-je dit à Tamara. A moins, lui ai-je dit, qu’on lui ait arraché son judaïsme et sa virilité, et que ce soit ça qui l’ait sauvé. »
L’épisode tient sa beauté de sa profondeur, mais aussi du contexte dans lequel il est raconté. En même temps qu’il raconte, le narrateur se rapproche de la jeune femme qui le désire, et qu’il désire. Le présent ne les a pas quittés : « J’ai cherché son dos, ses épaules, ses taches de rousseur, ses hanches larges, son cul rond et blanc, presque nu et saupoudré d’un fin duvet transparent. Sa main était posée sur ma cuisse. Au loin, les montagnes de Jordanie demeuraient grises et paisibles. » L’érotisme peut être une morale.
Norbert Czarny, Après-Auschwitz, n°355-356, Juillet-Septembre / Octobre-Décembre 2020
