Premiers combats. La démocratie républicaine et la haine des Juifs
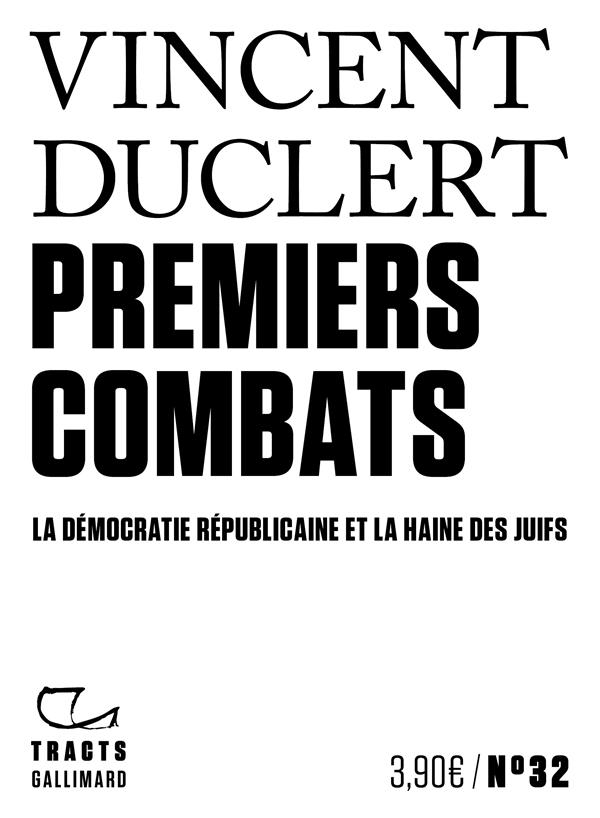
Ces dernières années ont été marquées par une succession d’épisodes antisémites en France : cris « Morts aux Juifs » (en janvier 2014 dans les manifestations contre le mariage pour tous à Paris ; en décembre 2018 lors des manifestations des gilets jaunes), remarques antisémites dans le contexte du Covid 19 et, surtout, assassinats d’Ilan Halimi le 13 février 2006, de trois enfants et un professeur de l’école Ozar Hatorah à Toulouse le 19 mars 2012, de plusieurs personnes à l’Hyper Cacher de Vincennes le 9 janvier 2015, de Sarah Halimi le 4 avril 2017 et de Mireille Knoll le 23 mars 2018. Partant de ces évènements, Vincent Duclert propose une réflexion sur le rôle de l’histoire et de la connaissance du passé pour lutter aujourd’hui contre l’antisémitisme. Revenant sur l’historiographie, particulièrement sur les études relatives à l’antisémitisme, « envisagé dans sa longue durée historique comme dans sa complexité sociologique et ses ressorts psychologiques », il regrette « les hésitations à ramener l’antisémitisme vers la Shoah » et surtout « la disparition presque complète d’un angle d’étude centré sur les réponses opposées à l’antisémitisme » (p. 7). Si la connaissance de l’antisémitisme s’impose pour le combattre efficacement, la connaissance des luttes contre l’antisémitisme semble centrale aussi. Ces luttes ont en effet été « un fondement de la société démocratique en construction et la base des progrès de liberté en République » (p. 8). Le but de son tract est de restituer ces combats, de croire en la démocratie et de trouver « le courage de se battre pour elle » (p. 8). Alors que les derniers témoins de la Shoah disparaissent, l’historien veut leur faire la promesse que les leçons de l’histoire seront entendues.
Dans une première partie, il propose une réflexion critique sur l’antisémitisme comme repli de la démocratie. Il montre d’abord que l’arme antisémite « ne vise pas seulement la destruction de la personne et de la vie juive mais atteint aussi ce qui est reconnu comme le rempart de la haine, à savoir la société démocratique » (p. 12). Aujourd’hui, ce sont trois doctrines de l’antisémitisme différentes qui coexistent en France et ailleurs : le racialisme totalitaire, l’anti-républicanisme conservateur et l’islamisme radical. Le déni face à cet antisémitisme, résultat de l’optimisme démocratique (p. 13), risque d’empêcher l’action. L’idée selon laquelle « les minorités devraient accepter les conséquences de l’appartenance minoritaire » (p. 17), celle selon laquelle les Juifs ont toujours été persécutés et qu’il y a là une forme de normalité (p. 18-19) ou encore le négationnisme (p. 20) sont des défaites de la pensée et des menaces. Enfin, la minimisation de l’antisémitisme sous toutes ses formes (par exemple l’argument selon lequel « l’antisémitisme serait prioritairement une question sociale, révélatrice de tensions ou de frustrations au sein de la société s’exprimant alors par cette voie » p. 22), empêche l’action et l’engagement de chacun contre l’antisémitisme.
Dans un deuxième temps, Vincent Duclert propose une analyse de la démocratie républicaine en lutte contre l’antisémitisme. A la fin du XIXe siècle, la lutte contre l’antisémitisme « a revêtu une intensité qui n’est jamais représentée ensuite, mobilisant des consciences individuelles aussi bien que des figures politiques, et d’autant plus décisive qu’elle a affronté les formes modernes de la haine des juifs » (p. 28). Il revient sur la haine des Juifs montante parallèlement à la démocratisation de la République à partir des années 1880. C’est un antisémitisme moderne qui se déploie alors, paré des habits « de la modernité intellectuelle, de l’élan du mouvement social et de la cause nationale » et qui épouse les inquiétudes collectives nées d’un monde en mutation (p. 31). Des intellectuels comme Anatole France ou Jean Jaurès s’opposent à la pensée d’Édouard Drumont (La France juive, 1886) et dénoncent qui les dangers de la racialisation d’une minorité, qui la question raciale plus généralement. L’Affaire Dreyfus constitue ce que Vincent Duclert appelle « l’antisémitisme triomphant » (p. 37). Mais c’est aussi le moment d’un combat frontal qui fait « l’honneur des intellectuels » (p. 39) comme Émile Zola, Bernard Lazare, Gabriel Monod, Lucien Herr, Élie Halévy ou Célestin Bouglé. Un « souffle démocratique dans la République » (p. 50) est aussi perceptible à travers l’action d’un Georges Clemenceau (avocat d’Émile Zola), d’un Jean Jaurès qui fait front contre l’antisémitisme que le gouvernement laisse se développer à la Chambre des députés ou d’un Waldeck-Rousseau. L’Affaire est toutefois progressivement oubliée au XXe siècle, ce siècle nouveau des tyrannies et des génocides écrit Vincent Duclert. On notera toutefois que dans l’entre-deux-guerres, l’Affaire Dreyfus marque profondément les Juifs européens, attirés par la France, ce pays qui s’est déchiré pour un Juif. Mais au XXe siècle, l’antisémitisme redeviendrait alors l’affaire des Juifs et leur responsabilité, même si des intellectuels comme Jean-Pierre Vernant se sont fait les héritiers d’une « pensée dreyfusarde et libérale » (p. 56) lors de l’attentat de la rue Copernic en 1980.
Vincent Duclert conclut son propos en appelant à se mettre dans les pas de ces intellectuels et hommes politiques qui se sont battus contre l’antisémitisme. Cette victoire démocratique est en effet toujours incertaine et l’humanité fragile : il importe de rester vigilant et de « ne pas renoncer à l’inquiétude qui fait penser et comprendre » (p. 58). La question se pose toutefois de savoir si la connaissance du passé et des luttes contre l’anti-sémitisme de la fin du XIXe siècle peut véritablement conduire à un sursaut républicain et démocratique face à l’antisémitisme d’aujourd’hui, à une époque fondamentalement différente, qu’il aurait été intéressant de mettre davantage en perspective avec le temps de l’Affaire Dreyfus. Vincent Duclert estime que oui et on aimerait le croire. L’histoire a en effet plus que jamais un rôle à jouer dans le débat public, face aux falsifications historiques et au retour de la haine antisémite.
Zoé Grumberg, Après Auschwitz, n°355-356, Juillet – Septembre / Octobre – Décembre 2021
