Sans droit à la vie
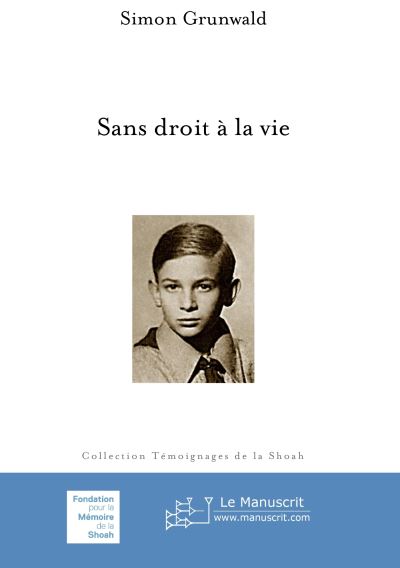
Cet ouvrage constitue mon témoignage sur la Shoah. Il dénonce l’extrême cruauté des événements que j’ai vécus pendant la Seconde Guerre mondiale en Pologne. J’y raconte les difficiles conditions de survie que j’ai connues, hors et dans les ghettos, ainsi que ma vie d’enfant caché. C’est l’histoire d’un enfant parmi des milliers, à qui on enleva le droit à la vie, ou comment un enfant heureux qui ne savait même pas qu’il était Juif, fut plongé dans la plus grande tragédie de son peuple.
Ce témoignage montre de manière irréfutable la participation massive des Polonais dans le génocide des Juifs de Pologne. Il rappelle aussi l’existence de quelques « Justes » prêts à aider, au péril de leur propre vie, ces Juifs en danger.
4ÈME DE COUVERTURE
Un livre coup de poing
Dans sa correspondance de 1904, Franz Kafka a écrit :
« Nous avons besoin de livres qui agissent sur nous comme un malheur dont nous souffririons beaucoup (…) comme si nous étions proscrits, condamnés à vivre dans des forêts, loin de tous les hommes, (…) Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous».
Rédigé en 2007 par Simon Grunwald, déjà septuagénaire, ce témoignage sur son enfance en Pologne pendant l’occupation nazie est implacable. Dans un livre d’une centaine de pages aux chapitres courts et au style sans pathos, il « dénonce l’extrême cruauté » de ce qu’il a vécu dans son pays natal durant la Shoah et il « démontre de manière irréfutable la participation massive des Polonais dans le génocide des Juifs de Pologne » (Quatrième de couverture), sans omettre de rendre hommage aux quatre Justes polonais qui lui ont permis de survivre.
Le lecteur est interpellé d’emblée par le titre Sans droit à la vie : Simon Grunwald utilise, pour se désigner lui-même, une locution construite sur le modèle de « sans-domicile-fixe », « sans-papiers », « sans-patrie », expressions que nous connaissons tous, avec leurs abréviations comme « SDF », parfaits euphémismes administratifs… Or la privation du droit de vivre infligée aux Juifs par les nazis constitue la pire de toutes les privations et le plus grave des crimes contre l’humanité : le génocide, organisé, il est vrai, par des bourreaux-fonctionnaires avant d’être perpétré par les soldats du Troisième Reich.
Dès sa prime enfance, Simon est exposé au danger mortel d’être né juif. C’est le leitmotiv de son témoignage. Quand éclate la guerre, il a presque six ans et sa petite sœur deux ans de moins. Issu d’une famille aisée et assimilée de Varsovie, il se décrit comme « un enfant heureux qui ne savait même pas qu’il était juif et qui fut plongé dans la plus grande tragédie de son peuple ». La découverte de sa judéité se produit au printemps 1940 lorsque les nazis arrêtent son père, qu’il ne reverra plus jamais, et font main basse sur son atelier et son magasin de fourrures. « Je compris alors que j’étais Juif. Mot qui me condamnait à mort. Je n’avais plus droit à la vie » (p.32)
Spoliés de leur appartement par une voisine polonaise qui les a dénoncés comme Juifs, Simon, sa mère et sa petite sœur passent un an au ghetto de Varsovie dans des conditions effroyables. Ensuite leur vie n’est plus qu’errance, de Varsovie à Lublin, car les survivants de la famille de Guitel, la mère de Simon, qui les accueillent dans leurs villages, sont expropriés à leur tour en 1942 et assassinés avec la complicité active des pillards polonais qui ne sont autres que leurs voisins. Chaque fois, grâce à la présence d’esprit de la « mère courage » de Simon, la petite famille réussit à fuir à temps, dans des conditions dramatiques, notamment lorsqu’ils se retrouvent dans la file des déportés en route vers le camp d’extermination de Treblinka.
Juste avant cet épisode, Simon, âgé de sept ans était déjà forcé, pour survivre, de travailler avec sa mère au nettoyage du ghetto d’Ottwock. Dès lors, Simon et sa sœur n’ont plus qu’une vie d’enfants traqués, obligés de mendier et de travailler chez des paysans polonais antisémites, cachés sous une fausse identité : Simon Grunwald devient Stasiek Rudski, petit polonais catholique. Il fait même sa première communion en 1944 comme l’atteste une photo (p.101). Pourtant, lorsque sa judéité est fortuitement démasquée, c’est un curé polonais qui le sauve de justesse en imposant silence à ses dénonciateurs.
Autre chance de survie, un couple de Justes polonais, les Duzyniek ont constamment aidé la petite famille aux abois. Ce fut le seul point de ralliement de Guitel, Simon et sa petite sœur Esther. Mais ils ne se retrouvaient que ponctuellement chez ces bienfaiteurs fidèles. Car pour survivre, tous trois devaient se séparer et travailler avec leurs faux papiers dans des fermes différentes. Après de multiples péripéties, la fin de la guerre arrive. La famille est saine et sauve mais Simon, à 10 ans doit encore se faire embaucher chez un boulanger pour aider sa mère qui voudrait bien l’envoyer à l’école. Ce souhait ne pourra se réaliser qu’en Allemagne, paradoxalement, où il apprend à lire et à écrire dans la zone occupée par les Américains.
Réfugiés à la recherche d’une nouvelle patrie, la mère et les deux enfants passeront par la France, puis Israël. A 25 ans, Simon revient en France, « le pays des Droits de l’Homme » qu’il ne quittera plus. Il y fonde une famille nombreuse en épousant une jeune fille qui fut enfant cachée, sauvée par une famille bretonne aimante, pendant que son père était prisonnier de guerre et que sa mère, malgré cela, fut dénoncée et déportée à Bergen-Belsen.
Ils furent des milliers, ces enfants juifs, traqués, cachés, forcés de mûrir précocement en luttant pour survivre. Parmi les témoignages qui recoupent celui de Simon Grunwald, on peut citer ceux du cinéaste Roman Polanski et de l’écrivain israélien Aharon Appelfeld.
Les premiers chapitres de l’autobiographie Roman par Polanski (Fayard, 2016) retracent l’enfance du cinéaste né à Cracovie en 1933. Il se retrouve au ghetto de cette ville au début de la guerre et avant les dernières rafles et la liquidation du ghetto, est confié par ses parents, contre rémunération, à une famille polonaise, sous le nom de Roman Wilk. Mais là, on le juge vite indésirable et on l’envoie chez les Buchala, des paysans misérables et arriérés, loin de Cracovie. Ses parents lui manquent terriblement mais il découvre la campagne, les saisons, la beauté de la nature. Comme les paysans, il a faim et travaille dur pour survivre. Pour protéger le secret de sa judéité, il récite avec eux les prières catholiques, partageant leur foi naïve et profonde.
Quant à Aharon Appelfeld, né en 1932 en Roumanie, il se retrouve seul au monde dans le ghetto de sa ville, puis déporté en 1941 dans un camp à la frontière ukrainienne d’où il s’évade en 1942 et survit caché dans la forêt. Dans Histoire d’une vie, (Éditions de l’Olivier, 2004, prix Médicis étranger), il écrit: (p.121-2) « la Seconde guerre mondiale avait éclaté et nos vies en furent bouleversées. En quelques semaines, l’enfant de sept ans qu’on avait entouré de chaleur et d’un immense amour, devint un orphelin de mère abandonné dans le ghetto, traîné par la suite avec son père dans une marche forcée à travers les plaines d’Ukraine. (…) A partir de là commença la condition d’orphelin, la solitude et le repli sur moi-même. (…) ». Comme Simon Grunwald, Aharon a travaillé dans des fermes : chez une femme ukrainienne d’abord, puis chez un paysan aveugle qui le maltraitait.
La condition de l’enfant pendant la guerre, c’était d’être comme « un brin de paille que tout le monde piétinait », (Histoire d’une vie, p.62), obligé de se méfier de tous et de préférer la compagnie de la nature, des animaux, et même des objets à celle des humains.
Aharon Appelfed et Roman Polanski devinrent de grands artistes. Simon Grunwald écrivit sur le tard des essais sur le destin du peuple juif, il n’est pas devenu célèbre, mais son témoignage sur son enfance, simple et facile à lire mérite d’être largement diffusé, notamment auprès des plus jeunes.
Ginette Mabille, professeure de lettres retraitée, Après-Auschwitz, n°357-358, Janvier – Mars / Avril – Juin 2021
