Se raconter le récit qui a manqué
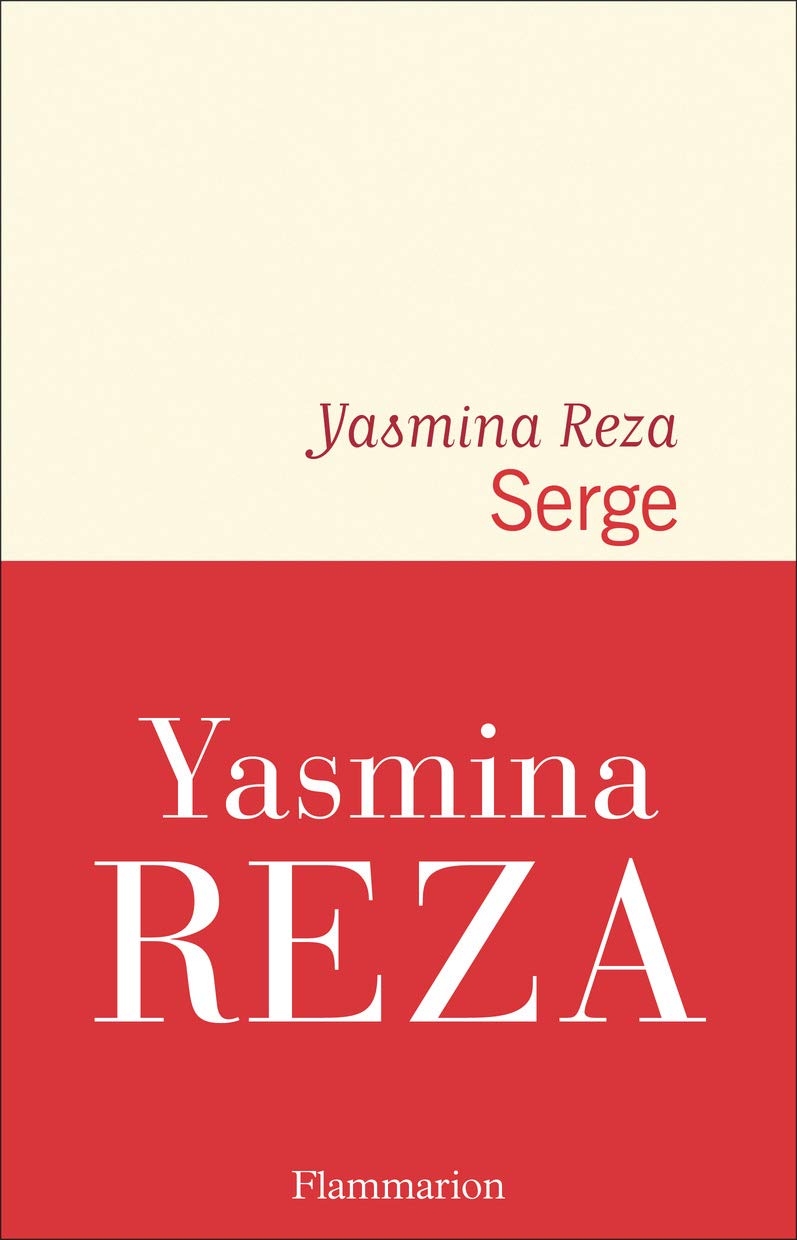
Les amateurs de théâtre connaissent Yasmina Reza. Arts ou Le dieu du carnage ont fait sa réputation. Les lecteurs la connaissent aussi, pour ses romans. Le dernier en date, paru en janvier 21 s’intitule Serge. Ce Serge-là est l’ainé d’une fratrie, sa sœur cadette Anne alias Nana est celle qui interprétait la méchante ou la plus faible, l’Indienne en somme, quand les garçons de la famille jouaient aux cow-boys. Le benjamin s’appelle Jean, il est comme l’ombre de son ainé. Il est aussi et surtout le narrateur de ce roman dans lequel le dialogue joue un rôle important, sans pour autant envahir le récit fait par Jean d’un voyage à Auschwitz.
Préciser que Jean est le narrateur est essentiel : on ne saurait attribuer à Yasmina Reza, auteure du roman, des pensées et propos qui se développent tout au long de l’intrigue. Fidèle à ce que dit Kundera du genre romanesque, elle laisse aux personnages leur liberté, et plus encore aux lecteurs. Des propos et pensées se confrontent, auxquels le lecteur adhère ou pas. Ce que pense Yasmina Reza lui appartient.
Nous découvrons cette famille juive à travers le récit de Jean. Le voyage vers la Pologne, c’est Joséphine, fille de Serge qui l’a souhaité, après la mort de sa grand-mère : « Notre mère s’était appliquée à n’être le maillon d’aucune chaîne, Joséphine […]semblait animée du désir contraire ». Marta Heltaï, cette grand-mère, « avait selon la formule de son fils Jean, ce tropisme si peu contemporain de n’être pour rien au monde victime. » Au point qu’entre elle et son mari, Edgar Popper, un mot suffisait pour que le ton monte. Un bon exemple : « Avec Israël, on tombait aussitôt dans l’enflure et le pathos ». Les trois enfants n’entendent donc pas parler du passé, ne savent rien ou presque de l’enfance de leurs parents.
Marta est une mère « insaisissable, capable de cajolerie et de dureté, de surprotection étouffante et d’abandon. » Edgar est un homme nerveux, susceptible et brutal : « Le grand chic de la violence paternelle résidait dans la disproportion et l’inopiné ». Les « torgnoles » tombent vite, surtout sur Serge, pas trop affecté par ces coups, mais sûrement marqué. Serge est un personnage, comme on les aime quand on aime les tordus : égocentrique, trompant tout le monde, se mentant à lui- même, il est capable de se dire malade du cœur et d’allumer une nième cigarette, il mange sans arrêt et surtout n’importe quoi. Il se comporte de façon puérile face à Valentina, sa compagne, face à sa sœur et à sa fille lors du voyage mémoriel, il peut bouder. On aime ses combines immobilières Montrouge avec Chicheportiche, ou ses coups d’éclat pour trouver un stage dans un grand hôtel suisse, à son neveu Victor.
Serge est le contraire de Jean, plus posé, distant, qui observe. Le contraire aussi de Nana, sa sœur, qui travaille dans le social et qui se sent « bouleversée de pouvoir valoriser des parcours civiques ». Elle a épousé un Espagnol, reçu par son père comme un chien dans un jeu de quilles, avant qu’Edgar ne décède. Le portrait de Ramos Ochoa est un modèle de méchanceté. Jean le qualifie de « personnage secondaire ». L’expression « à bas bruit » qui revient peut caractériser le physique comme le comportement du bonhomme.
Autant le dire, on sourit souvent, on rit aussi en lisant Serge, et parfois, tout grince. Une expression yiddish peu traduisible dit en substance « Y a pas de quoi rire ». Elle convient tout à fait ici. Le temps qui passe, défait ou détruit est là, omniprésent, avec notamment le sort de Maurice, vague cousin russe d’Edgar et une sorte de parrain pour les trois enfants. La mort aussi est là, celle des parents bien sûr, mais celle des déportés plus encore, que la famille appréhende lors de ce voyage à Auschwitz.
Tel est le cœur du roman, une cinquantaine de pages après que l’on a fait connaissance avec tous les personnages. Le voyage mémoriel n’est pas un genre ou un topos, mais quelques romans montrent ce qu’il en est. Le monstre de la mémoire d’Yishaï Sarid poussait la question à son comble, et j’avais cité ici Excursion Auschwitz Birkenau, d’Andrzej Brycht. On suit les personnages qui, d’une certaine façon, suivent leur père, marqué par le visionnage de Shoah. Jean se le rappelle : « Les images du film de Lanzmann ont forgé un territoire mental, un pays de nature feuillue et impavide. » Les éléments de décor sont forcément décalés. Une maison fleurie, une route, cela détone. « Auschwitz est la bourgade la plus fleurie que j’aie jamais vue de ma vie.» Le flux ou flot de touristes dans le camp I ajoute à cette impression, avec ces gens en tenue de semi-plage […] combi-shorts, robes florales » défilant serrés dans la chambre à gaz. Trop pour Serge, claustrophobe. Il reste à l’extérieur, fumant sa cigarette.
Tout est décalage, tant dans la visite que dans les paroles échangées, les dialogues entre frère et sœur, père et fille, ou dans les scènes captées tout autour. « Des Israéliens enveloppés dans leur drapeau font un genre de ronde au milieu des cars ». Dans le vestiaire qui précède la chambre à gaz, ce que remarque Nana fait l’objet d’une parenthèse : une chaussure à semelle compensée, comme de nos jours. La vie continue et c’est à la fois stupide, presque obscène, et compréhensible. Rien n’est univoque et ce roman nous tourmente parce qu’il joue constamment sur le paradoxe.
Et puis il faut composer avec ce qui disparaît, avec ce que le temps détruit. Ainsi, les cheveux « derniers restes humains couvés par les scientifiques pour ne pas tomber en poussière » forment une « masse houleuse et grise de chanvre ». Bien des historiens, des chercheurs, des philosophes se sont demandé quel sort devait être celui d’un tel lieu de mémoire. Personne n’a la réponse ou bien toutes les réponses sont bonnes. Mais toutes ont une contrepartie terrible : le kitsch, l’oubli total, la récupération. Est-ce le lieu exact du « Souviens-toi ? » Jean en doute qui s’interroge sur ces lieux et les rangées omniprésentes de peupliers masquant à peine le musée : « Une parcelle de limbes réorganisée pour le visiteur contemporain. Un geste noble qui opacifie. »
Serge refuse de regarder Birkenau. Or c’est le seul lieu dont la nudité est évoquée sans la moindre distance : « Au-delà du portail on entre dans un lieu dévoué à la mort. L’évidence de cette attribution saute aux yeux. C’est elle qui est vertigineuse. Aucun faux-semblant. Les rails vont droit à la mort. Toutes les routes y mènent tôt ou tard. »
Sans doute est-ce ce qu’a éprouvé Monsieur Cerezo, le professeur de philo qui chaque année conduit ses élèves à Auschwitz, et parmi eux Margot, la fille de Nana. Il s’abîme au double sens du verbe, dans ce moment, et Jean comprend ce geste : c’est lui qui a raison […]. On ne doit pas pleurer les disparus des camps autrement que fanatiquement. »
Mais que peut-on, face au temps et à l’oubli, que peut-on quand, « oscill[ant] entre froideur et recherche d’émotion qui n’est autre qu’un certificat de bonne conduite » on ne sait comment être ?
Une terrible mélancolie traverse ce roman et elle est sans remède, quand Jean évoque ceux qui ont connu le camp, qui ont eu faim et froid : « Les déportés qui sont revenus avec leurs chapeaux et leurs grosses fourrures pour dieu sait quelle commémoration ont à présent rejoint les anciens morts. C’est une race particulière de vieux, perdus dans des manteaux démesurés, empaquetés dans des habits de froid qui les engoncent, des gens d’un autre temps qu’on ne reverra jamais. Sans eux, le lieu n’existera plus. […] Ils emportent avec eux un siècle et un continent. »
Oui, sans doute, un monde disparaît, fait de vieux survivants qui s’efforcent de parler jusqu’au bout, jusqu’à perdre le mince filet de voix. Ils racontent, ils disent les lieux, ils disent les visages et nous les écoutons avec attention, comme Lanzmann a écouté Abraham Bomba, le « coiffeur » de Treblinka. Le plus important est là : ne jamais cesser d’écouter une voix, fût-elle seulement réduite à un filet.
Norbert Czarny, Après-Auschwitz, n°355-356, Juillet-Septembre / Octobre-Décembre 2020
