Seul dans Berlin
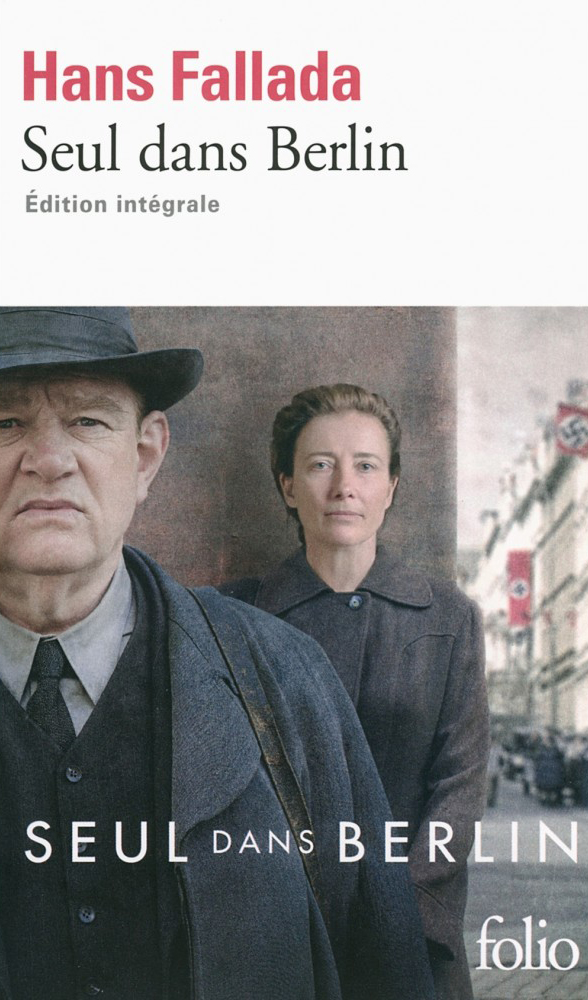
Dans l’Allemagne de l’entre- deux-guerres Rudolf Ditzen (1893- 1947) s’était fait connaître, sous le pseudonyme d’Hans Fallada, comme romancier du petit peuple en proie aux souffrances de la terrible crise qui ravageait le pays. Son roman Quoi de neuf, petit homme ? (Kleiner Mann – was nun ? 1932), avait connu un très grand succès. C’est en 1946 qu’il écrit, en deux mois seulement, dans la zone sous contrôle soviétique (qui allait devenir la RDA), Jeder stirbt für sichallein (Chacun meurt pour soi, seul), qui sera traduit en France sous le titre Seul dans Berlin. Il meurt quelques mois plus tard, exténué, au terme d’une vie tumultueuse, maintes fois interné dans des institutions psychiatriques, usé par les dépendances à l’alcool, à la morphine, aux somnifères.
Le sujet du roman lui avait été proposé par Johannes Becher, responsable culturel du Parti Communiste allemand -qui deviendra Ministre de la Culture de RDA-. Il avait remis à Fallada un dossier de la Gestapo sur la traque d’un couple d’ouvriers berlinois, Otto et Elise Hampel, qui, pendant plus de deux ans, avaient écrit des tracts et des cartes appelant la population à la résistance contre le régime hitlérien, qu’ils déposaient un peu partout dans Berlin. Arrêtés en septembre 1942, ils avaient été condamnés à mort et pendus dans la prison de Plötzensee.
Le livre paraît en 1947 chez l’éditeur Aufbau-Verlag. Fallada, décédé le 5 février, n’a pu relire les épreuves de ce vaste roman. Or, celui- ci a été amputé de près d’un tiers. De nombreux passages et même un chapitre entier (le chapitre 17) ont disparu. Les œuvres publiées dans la zone soviétique cherchent à donner une représentation idéalisée de la lutte contre le nazisme et du peuple allemand qui a pu être abusé, écrasé par une dictature, mais qui, dans ses profondeurs, ne s’est pas donné au national-socialisme. Mais, les dossiers de la Gestapo révélaient une réalité plus complexe. On y apprenait que la factrice Eva Kluge ainsi que les Quangel (nom de fiction des Hampel), avant de devenir des résistants, avaient appartenu au parti national- socialiste ou à des organisations satellites. Et le roman donnait sur la vie quotidienne des Berlinois et sur le fonctionnement de la police nombre de détails véridiques et gênants. Il faudra attendre 2011 pour que paraisse une nouvelle version, intégrale cette fois, toujours chez Aufbau. En France, en 2014, une nouvelle traduction, par Laurence Courtois, est publiée chez Denoël.
« Vérité intrinsèque » de la fiction
Les dossiers de la Gestapo ont fourni à Fallada l’ossature de son roman. Celui-ci commence en juin 1940, le jour de la capitulation de la France, jour de liesse pour le régime et ses partisans. C’est ce jour-là, qu’Otto et Anna Quangel, un couple d’ouvriers berlinois, apprennent que leur fils unique est mort au combat. Ce drame va déterminer ces deux admirateurs du Führer à entrer en résistance et à déposer partout dans la ville des cartes manuscrites dénonçant la guerre et le régime national-socialiste. Déjouant durant plus de deux ans les recherches de la Gestapo et de l’inspecteur Escherich, ils déposent près de 300 cartes. Arrêtés, ils apprennent, que leur combat a été vain, les cartes ayant été dans leur quasi-totalité aussitôt remises à la Gestapo. La fin du livre raconte la parodie de procès qui conduit les époux à la mort.
Hans Fallada a donné à cet argument de base une ampleur singulière. Le romancier qu’il était ne pouvait se borner à une simple mise en forme romanesque de l’archive. Il l’explique nettement dans un bref avant-propos liminaire : « Un roman a ses propres règles et ne peut reprendre la réalité en tous points ». Il y affirme sa conviction que le roman a la capacité de dire le réel, de donner de l’expérience historique une figuration satisfaisante. La fiction constitue un moyen d’accéder à la vérité : « l’auteur, écrit-il, croit à ‘la vérité intrinsèque’ de ce qui est raconté, même si certains détails ne correspondent pas exactement à la situation réelle ». La lecture de Seul dans Berlin offre ainsi un exemple où s’interroger sur la capacité du roman à transcrire l’expérience de l’histoire.
55, rue Jablonski, Berlin
L’imagination créatrice du romancier a inspiré à Fallada un projet littéraire audacieux, celui de montrer la vie ordinaire des Berlinois dans les années 1940 – 1943 et leur confrontation quotidienne au nazisme, à travers la description de la vie des habitants d’un immeuble. L’immeuble est situé au 55 rue Jablonski, dans le quartier populaire de l’Alexanderplatz. En parcourant les étages, on rencontre, en plus des époux Quangel, le magistrat Fromm, à la retraite depuis 1933 ; les Persicke, une famille de fervents nazis, dont les fils appartiennent à la SS ; une vieille femme juive, Frau Rosenthal, séparée de son mari qui a été arrêté, et vivant seule dans l’angoisse. Au
bas, de l’immeuble rôde Barkhausen, un vil mouchard. Tous les matins, la factrice Eva Kluge monte les marches de l’escalier. Elle vit séparée de son mari Enno, parieur et coureur de femmes. Tous personnages dont les vies seront affectées par la décision d’Otto Quangel d’entrer en résistance.
Le système nazi, les systèmes totalitaires en général, ont été analysés par de nombreux philosophes, historiens ou politologues, d’un point de vue général et abstrait. Dans Seul dans Berlin Fallada entreprend de montrer l’histoire vue depuis les ruelles et les cours d’un quartier populaire. Comment vivait-on au jour le jour sous le joug national-socialiste, dans les ruelles d’un quartier populaire, dans les usines, dans les boutiques ? De quoi parlait-on chez les ouvriers, les commerçants, dans le petit peuple de Berlin ? Un tableau saisissant s’en dégage, éclairé par une lumière impitoyable.
Nous savons comment l’Allemagne officielle, celle des dignitaires nazis, a célébré la victoire sur la France. Ce que nous ne savions pas, et que Fallada nous montre, c’est la victoire vue d’en bas. Chez les Persicke, toute la famille est nazie. Le père, un vieil ivrogne, cafetier ruiné, convoite depuis longtemps les biens de la vieille dame juive, désormais seule au dernier étage. Il fête la victoire en une déclaration qui traduit la vérité du nazisme dans le langage des bas-fonds : « Aujourd’hui la France a capitulé, et cet après-midi on ira p’têt chez la vieille youpine au quatrième, et tu vas voir que la vieille garce va nous servir son café et ses gâteaux ! Je vous dis que ça, moi, la vioque elle va cracher (…) maintenant on est les rois du monde ».
Le Berlin de ces années-là est d’abord un monde de la peur. Comme, plus tard, Arendt, Friedrich ou Lefort, Fallada voit dans la terreur généralisée, entretenue par un appareil policier appuyé sur un immense réseau de surveillance, un des ressorts fondamentaux du pouvoir nazi. La peur est partout, dans tous les instants du jour, dans tous les cauchemars de la nuit. C’est la peur de la Gestapo, la peur d’être envoyé sur un simple soupçon en camp de concentration, la peur de la prison de Moabit ou de la potence de Plotzen. C’est la peur de celui qui est interrogé par la police et qui n’est plus « qu’un morceau de gélatine, une petite motte d’angoisse ». Les nazis eux-mêmes semblent avoir peur : « Avec leurs braillements, ils ne dissimulaient que mal leur peur d’être un jour renversés ». Le système concentrationnaire, pour n’apparaître qu’indirectement, n’est pas moins effrayant, menace brandie tout à coup par un mouchard, au coin de la rue :
« Pour une sortie de ce genre, je peux t’envoyer en camp de concentration ».
Toute la population est surveillée par un réseau de mouchards et de dénonciateurs. Toute parole peut être rapportée. Tout individu est un suspect : « Tout le monde avait quelque chose à cacher ». Le personnage clé est celui de l’inspecteur de police. Il a pour mission, non de trouver des coupables, mais de vérifier que chacun est coupable : « L’inspecteur Laub travaillait suivant le principe de cette époque : tout le monde a quelque chose sur la conscience. Il suffit de chercher assez longtemps, et on trouve toujours quelque chose ». Seul dans Berlin tient du roman policier (un roman policier au dénouement immuable, les geôles de la Gestapo), l’inspecteur Escherich est le Sherlock Holmes sinistre et pitoyable de ce monde maudit.
Les sentiments purs, les aspirations nobles ont disparu du Berlin nazi. Tout est dégradé, souillé, avili. La vie et le langage y sont en proie à un ensauvagement, à une « brutalisation ». Dans tout le roman retentit un langage de violence et de haine, de hurlements et d’injures. Les crimes, les tortures accompagnent les scènes de sadisme et d’ivrognerie. Dans son avant- propos, Fallada répond à ceux qui lui reprocheraient d’avoir dressé un tableau si sombre : à cette époque, dit-il, avec une sorte d’humour noir « la mort était très en vogue », si bien que « plus de lumière aurait signifié mentir ».
« Le plus beau livre jamais écrit sur la résistance allemande anti-nazie », Primo Levi
Les Quangel mesurent parfaitement l’absurdité apparente de leur combat, eu égard à la disproportion des forces, « la guerre entre eux d’un côté, les pauvres et insignifiants petits ouvriers, qui à cause d’un mot pouvaient être éliminés pour toujours, et de l’autre le Führer, le parti, ce monstrueux appareil avec tous ses pouvoirs et son éclat, et les trois quarts, oui, les quatre cinquièmes même de tout le peuple allemand derrière eux. Et tous deux ici, dans cette petite pièce de la rue Jablonski, tous les deux tout seuls ! ». Pourtant, leur engagement est total. La première carte est une déclaration de guerre sans merci : « Mère ! Le Führer a assassiné mon fils ! Mère ! Le Führer va aussi assassiner tes fils, il n’arrêtera pas (…) ». Leur résistance prend sa racine dans le refus d’une guerre perçue comme un monstrueux assassinat des enfants : « On ne met pas les enfants au monde pour qu’ils aillent se faire tuer ». Cette réaction est spontanée, quasi instinctive. La résistance au mal absolu est le fait de gens simples, sans culture, isolés, mais qui ont le sentiment qu’il y a des choses qui ne se font pas, qui ne sont pas convenables, terme utilisé maintes fois par les résistants du livre, Otto, ou la factrice Eva Kluge. Comme Orwell (1984 sera publié en 1949, deux ans après Seul dans Berlin), il fait confiance aux qualités des gens simples, à leur décence commune (common decency), ces valeurs de solidarité, d’entraide, de bienveillance que l’on observe chez les résistants et résistantes de Seul dans Berlin.
Dans son duel final avec Escherich, qui ironise sur la vanité de son entreprise -un simple ouvrier qui a voulu lutter contre « le Führer et toutes les forces derrière lui » !-, l’humble Quangel trouve des mots inattendus, il se réclame d’un impératif catégorique, à la façon d’un héros kantien : « Peu importe qu’il n’y en ait qu’un qui lutte ou bien dix mille ; quand celui-là se rend compte qu’il doit lutter, alors il lutte, qu’il y ait des gens qui luttent à ses côtés ou non. Il fallait que je lutte, et si c’était à refaire, je le referais ». Plus tard, dans la cellule où il attend la mort, Otto a pour compagnon un musicien raffiné, ouvert et bienveillant. À cet homme si différent de lui, Otto confie l’angoisse qui, malgré la réplique bravache lancée à Escherich, le taraude toujours : les cartes n’ont servi à rien ! A quoi son compagnon répond, et il est difficile de ne pas entendre la voix même de Fallada à travers celle de ce personnage dont la noblesse en impose même aux gardiens qui l’appellent « Herr Doktor » : « Malgré tout vous avez résisté au mal. Vous n’êtes pas devenu mauvais comme les autres ». Notre résistance n’a pas été vaine, explique- t-il : « A nous, ça nous aura beaucoup servi, parce que nous aurons pu nous considérer comme des personnes convenables jusqu’à notre mort. Et ça aura servi plus encore au peuple entier, qui sera sauvé à cause des justes comme il est dit dans la Bible ». Il n’était pas possible de faire autrement dans la situation de l’Allemagne, « nous avons été obligés d’agir tout seul, pour soi, et c’est tout seuls que nous sommes enfermés, et c’est tout seuls que nous devrons mourir. Mais ce n’est pas pour autant que nous sommes seuls, Quangel, ce n’est pas pour autant que nous mourrons en vain. Rien n’arrive en vain dans ce monde, et puisque nous luttons contre la violence brutale, pour la justice, alors nous serons tout de même les vainqueurs à la fin ». Par ces phrases du « Doktor », Fallada souligne la grandeur de cet obscur Otto Quangel. Ce « petit homme » qui mettait ses cartes postales dans les escaliers devient l’incarnation de l’Allemagne souterraine qui résistait à l’infamie.
Alain Pujat, Après-Auschwitz, n°349, Printemps 2019
