Une femme face à l’Histoire
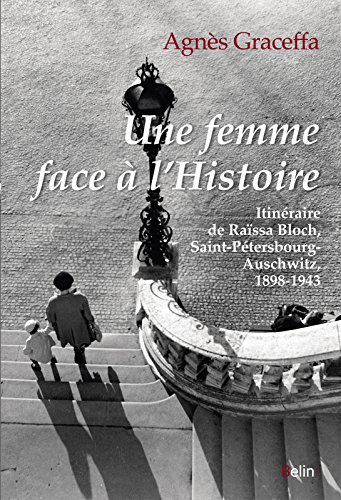
Écrire une biographie, en l’occurrence celle de Raïssa Bloch (1898-1943), retracer l’itinéraire d’une personne, ainsi côtoyée des années, est toujours « une expérience humaine », comme l’écrit Agnès Graceffa en prélude de longs remerciements aux descendants de proches qu’elle a rencontrés et aux archivistes qui l’ont guidée dans sa « quête ». Son beau livre est « né de la découverte fortuite de plusieurs lots de lettres de Raïssa Bloch et de Michel Gorlin [son mari] à leurs amis », notamment à la bibliothèque de l’Institut (fonds André Mazon, fonds Ferdinand Lot) et à l’Institut des études slaves (fonds André Mazon, fonds Michel Gorlin). Usant également d’archives russes et allemandes, de Mémoires de contemporains et des quelques recherches déjà publiées de chercheur.e.s européens et états-uniens, il fait connaître en France, où elle a vécu près d’un quart de sa vie, cette figure de poétesse, traductrice et historienne spécialiste d’histoire médiévale.
Agnès Graceffa s’est sans doute demandé comment écrire au mieux cette biographie. Le titre principal – « Une femme face l’Histoire » – apparaît bien choisi, tant Raïssa, juive russe née en 1898, est confrontée à tous les événements, et aux pires, de l’histoire européenne de la première moitié du XXe siècle : les guerres, la révolution russe, la crise économique, le nazisme, l’occupation de la France et le régime de Vichy, la Shoah. Les huit chapitres, qui suivent la chronologie d’une courte vie, font découvrir, avec force contextualisations, les milieux de l’intelligentsia russe d’avant 1914 et ses rapports complexes avec la révolution bolchevique, le monde des exilés russes à Berlin, le cercle des études slaves et des médiévistes en France ; ils explicitent également les effets individuels de la montée de l’antisémitisme en Allemagne, le refuge que représentent la France républicaine et les solidarités qui s’y déploient, le piège qui se referme avec l’occupation allemande du pays et la politique antisémite du régime de Vichy. Ces chapitres sont précédés d’un avant-propos et d’un prologue. Utile à la lecture qui va suivre, le premier campe en quelques phrases l’itinéraire de l’intellectuelle qu’est Raïssa, un itinéraire d’exil qui la conduit de sa Russie natale à l’Allemagne, puis en France. Le prologue, qui s’ouvre sur la lettre envoyée à André Mazon le 16 juillet 1942, fait entrer dans la tragédie finale : prévenue par un policier de sa connaissance, Raïssa vient d’échapper à la rafle du Vel d’Hiv et annonce à André Mazon, professeur au Collège de France et directeur de l’Institut des études slaves, qu’elle lui envoie temporairement sa fille et sa nourrice ; elle lui demande également de « sauver » son mari, juif polonais arrêté le 14 mai 1941, interné à Pithiviers et pour qui elle craint une nouvelle menace.
La première partie de la vie de Raïssa Bloch se déroule dans la Russie tsariste puis bolchevique. Née dans une famille juive assimilée de la bourgeoisie lettrée de Saint-Petersbourg, elle et son frère ainé Jacques, comme nombre de leurs cousins, bénéficient d’une bonne éducation polyglotte et d’une aisance matérielle. Forte en 1910 de 10 000 étudiants, la capitale russe connait alors une effervescence artistique et culturelle où dominent le théâtre et la création poétique : l’une des figures en est Anna Akhmatova. La guerre voit sans doute la jeune fille, comme ses condisciples revêtir le costume d’infirmière. La révolution de février 1917, qui se déroule sous ses fenêtres, enthousiasme la jeunesse étudiante et les intellectuels mais les suites d’octobre (armistice avec l’Allemagne, pénuries et famine, guerre civile et répression bolchevique) font fuir de nombreuses familles bourgeoises. Les Bloch – Raïssa, sa mère veuve, son frère et sa femme Hélène – décident de rester, contraints cependant d’emménager dans un appartement plus modeste. Raïssa fait des études de philologie et d’histoire. Sous l’influence d’Olga Dobiache-Rojdestvenskaïa, ancienne étudiante de Charles-Victor Langlois, amie du couple Ferdinand Lot- Myrrha Lot-Borodine, première maitresse de conférences en histoire à l’Université de Petrograd, elle se spécialise en histoire médiévale et devient l’assistante de sa professeure pour retranscrire des bulles papales du XIe siècle.
Fidèle à l’atelier de traduction de Mikhaïl Lozinski qui fait traduire en russe José-Maria de Heredia, elle participe à l’expérience de la Maison des Arts et au projet Littérature mondiale, bientôt admise à l’Union des poètes où on lit et discute les productions de chacun. De son côté, son frère cofonde fin 1917 une librairie d’occasion, Petropolis, qui devient quelques années plus tard une maison d’édition qui publie les poètes contemporains et diffuse les classiques étrangers. Raïssa, Jacques et Hélène se lancent dans la traduction des œuvres complètes de Carla Gozzi ; elle-même traduit seule La Mandragore de Machiavel. Mais le régime en butte à de graves difficultés fait de l’intelligentsia un de ses boucs émissaires : arrestations (dont celle de Raissa et Hélène pendant deux mois) et exécutions de l’automne 1921, fermeture de la Maison des Arts l’année suivante, arrestation et bannissement des membres du Comité d’aide aux affamés. Grâce à des appuis, Raïssa et sa famille, qui rêvaient de Paris, ont la chance de pouvoir partir officiellement en octobre 1922 à Berlin, la jeune historienne étant envoyée en mission pour six mois aux Monumenta Germaniae Historica (MGH), le célèbre institut d’édition de textes médiévaux.
Octobre 1922-mai 1933 : le séjour à Berlin, qui compte en 1922 un demi-million d’émigrés russes, s’est prolongé jusqu’à une nouvelle fuite, consécutive à l’installation du régime nazi. Pendant ces plus de dix années, Raïssa a repris des études, soutenu une thèse sur la politique monastique du pape Léon IX (1927), publié un recueil de poésies dédié à sa mère qui venait de disparaitre (Ma ville, 1928), rencontré dans un cercle littéraire le jeune Michel Gorlin, de 11 ans son cadet, avec qui elle a fondé le Club des poètes russes, obtenu la nationalité allemande qui lui sera retirée par le régime nazi. C’est alors une intellectuelle précaire qui peut bientôt ajouter à des cours particuliers ou des traductions alimentaires un travail à la tâche aux MGH pour son ancien directeur de thèse, Albert Brackman, tenant de l’Ostforschung (recherche sur l’Europe orientale), proche politiquement du parti nazi. Petite main érudite du grand œuvre MGH, elle joue le rôle d’intermédiaire entre les communautés scientifiques russes, allemandes et françaises mais perçoit de maigres émoluments et dispose de peu de temps pour des recherches personnelles sur les relations de parenté entre élites saxonnes et russes ou sur la poétesse du Xe siècle Hrosvita de Gandersheim. De plus, sa bonne intégration, tout comme celle de Michel Gorlin inscrit en thèse d’études slaves, se heurte à la montée de l’antisémitisme, qui s’exacerbe après la prise du pouvoir d’Hitler. Alors que Brackman lui avait promis un poste d’enseignante pour 1933, elle est remerciée des MGH le 31 mars. Elle multiplie les contacts et les recommandations auprès de Ferdinand Lot, puis part pour Paris. Après avoir soutenu sa thèse fin mai, Michel fait de même, enregistré comme réfugié auprès de l’Ofpra, tandis que Jacques et Hélène qui ont relancé Pétropolis à Berlin y restent jusqu’à l’aryanisation de leur entreprise en mai 1938.
Le Paris républicain est un havre de paix où la solidarité pour les Russes émigrés et les savants israélites allemands est réelle. Lot trouve un logement et du travail, notamment pour la nouvelle édition du Dictionnaire Du Cange du latin médiéval, grand projet international dont il a la charge. Mais cela est insuffisant pour vivre et Raïssa, qui écrit que sa « force de caractère s’est complètement affaiblie à cause d’Adolf », doit de nouveau multiplier les activités et délaisser ses propres recherches. Ce sont cependant des années de bonheur : mariage avec Michel en octobre 1935, activité littéraire, naissance de Dora en septembre 1936, insertion professionnelle de Michel qui devient en 1937 bibliothécaire à l’Institut d’études slaves dirigé par André Mazon, son directeur de thèse française.
« C’est en vain que nous avons accordé une grande estime à l’Europe », écrit Raïssa à un cousin d’Amérique le 19 août 1939, peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Depuis plusieurs mois, le couple pense de nouveau à l’exil et rêve d’un poste universitaire pour Michel aux États-Unis, seul moyen d’obtenir un visa. Avec l’occupation allemande de la France et l’installation d’un régime antisémite, la situation de Michel et Raïssa, étrangers et juifs, devient très difficile. Inexorable, la machine répressive déjoue les espoirs, toujours plus rapide que les solidarités, mais ni le couple, ni tous ceux qui les aident, n’imaginent Auschwitz. Le 13 mai 1941, Michel fait une communication sur des aspects de sa recherche à l’EPHE. « Insouciant de toute chose excepté les choses intellectuelles » comme l’écrit Raïssa, il répond sans méfiance à une convocation et se rend le lendemain au commissariat où il est arrêté. La mobilisation récurrente des amis, notamment de Léon Beaulieux, d’André Mazon et de Ferdinand Lot qui connaissent bien Jérôme Carcopino (sous- secrétaire d’État à l’Éducation et à la Jeunesse) et écrivent également au préfet du Loiret, échoue à le faire sortir du camp de Pithiviers. Matricule 508, Michel survit par les livres et l’écriture, également par les visites clandestines de Raïssa sur son lieu de travail après qu’il ait été détaché à la bibliothèque de Pithiviers. Il est déporté le 17 juillet 1942 et meurt à Auschwitz le 5 septembre, alors qu’André Mazon venait d’obtenir son recrutement à la New School of Social Research de New York et les visas pour la famille.
De son côté, Raïssa, qui a confié sa fille à André Mazon, réussit à passer en zone sud. Elle rejoint dans la Creuse une maison de l’OSE (Organisation de secours aux enfants) dirigée par son frère Jacques, puis travaille sous un faux nom à Vic-sur-Cère, dans une maison d’enfants de l’Amitié chrétienne, tout en continuant divers travaux intellectuels. Elle peut récupérer Dora qui, succession de malheurs, décède dix jours plus tard d’un croup fulgurant (27 octobre 1942). En 1943, face aux arrestations dans le réseau OSE, Jacques et Hélène partent à Chambéry pour être exfiltrés en Suisse. En principe non refoulable comme membre d’une organisation humanitaire internationale, inscrite à cet effet sur une liste remise aux autorités suisses, Raïssa passe la frontière avec cinq enfants le 18 octobre, mais le douanier ayant mal orthographié son nom (Gorlain), elle est expulsée le 21 sans enquête approfondie, arrêtée par la douane allemande à Annemasse, transférée à Drancy le 25, puis déportée à Auschwitz par le convoi 62 du 20 novembre 1943. De Drancy, elle a écrit aux amis pour obtenir des vêtements chauds, prier de « trouver » et « soutenir » Michel s’il revient avant elle, préciser qu’elle est en bonne santé et que « tous les malheurs [l’] ont rendue assez indifférente ». Du train, elle jette le dernier mot griffonné à envoyer à « Monsieur Beaulieux », disant l’amitié et l’espoir de se revoir, donnant une adresse à Chambéry pour prévenir son frère. À l’arrivée, elle est parmi les 895 personnes (sur 1181) non sélectionnées pour le travail.
Comme Agnès Graceffa, lecteurs et lectrices seront impressionnés par le courage et la force de vie de Michel Gorlin et Raïssa Bloch, comme par le tragique de leur destin de juifs européens. La mécanique nazie d’assassinat est extrêmement efficace mais le génocide reste une opération secrète et peu imaginable. Lorsque Raïssa est déportée, son mari est mort depuis plus d’un an – l’acte de décès rédigé par les SS indique pour cause une pneumonie – mais elle a continué à se préoccuper de lui et à envisager son retour. Plus âgée et épuisée par le malheur, elle est sans doute immédiatement gazée à son arrivée à Auschwitz. Peut alors paraitre dérisoire une discrimination de genre, suggérée dans l’ouvrage qui décrit le monde de l’Université et de la Recherche dans les trois pays où a vécu Raïssa : pas plus diplômé ou auteur que sa femme, plus jeune mais homme, Michel est le seul à qui sont offerts un poste permanent de bibliothécaire puis un poste universitaire. À côté des photographies familiales du cahier central photographique, un cliché attire l’œil, celui de Ferdinand Lot entouré de ses étudiants à la Sorbonne en 1933 : sur une cinquantaine, près des deux tiers sont des jeunes femmes, toutes alors « indésirables » à l’Université pour enseigner, comme l’a bien montré Christophe Charle.
Après guerre, les nombreux amis de Michel et Raïssa leur ont rendu hommage en publiant, en 1957, Études littéraires et historiques (inédits et notices biographiques, Institut des études slaves), puis, en 1959, une anthologie de leurs poésies en russe. Mais il manquait ce travail d’ampleur sur ces deux vies pleines de potentialités, fauchées dans la fleur de l’âge.
Françoise Thébaud, Après Auschwitz, n°351-352, Octobre – Décembre 2019
