Z ou souvenirs d’historienne
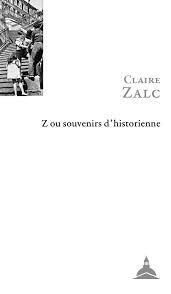
Claire Zalc est historienne, chercheuse, et, à ce titre, elle doit écrire un mémoire d’H.D.R. : pour qui ne le sait pas, « habilitation à diriger des recherches ». C’est un texte empreint d’une certaine scientificité : « Le dossier de candidature doit être accompagné d’une « synthèse de l’activité scientifique du candidat permettant de faire apparaître son expérience dans l’animation d’une recherche ». Le « je » peut apparaître mais avec mille précautions. Le dit dossier sera lu par des autorités diverses, et une partie de la carrière se joue sur ce document.
Le texte « scientifique » par lequel Claire Zalc explique sa démarche, ses méthodes et ses objets d’étude alterne avec un texte plus personnel, qui débute rue Vilin, à Belleville, là où Cécile Schulevitz, mère de George Perec, disparue à Auschwitz, avait son salon de coiffure. Cette alternance marquée jusque dans la typographie rappelle la construction de W, Un souvenir d’enfance, paru en feuilleton dans La Quinzaine littéraire de Maurice Nadeau, avant d’être édité par ce même Nadeau chez Denoël. Dans ce livre, deux récits : l’un raconte des sortes de Jeux Olympiques, Les épreuves s’apparentent à une mécanique totalitaire. Les techniques oulipiennes si importantes pour l’écrivain mettent en lumière une forme de terreur. L’autre récit, lacunaire, est autobiographique : l’écrivain revient à ses origines, et à l’origine d’une disparition que pourrait illustrer la lettre E dans La Disparition, celle liée à la Shoah.
Claire Zalc est en effet une grande lectrice de Perec, et elle lui emprunte des formes d’écriture pour raconter son parcours dans Z ou souvenirs d’historienne : « Influences directes ou indirectes, c’est comme si j’avais suivi Perec jusqu’ici, dans ses énumérations, ses manières de chercher des traces, son rapport à l’Histoire avec sa grande hache, ses méthodes d’écriture, son attention aux classements et aux catalogages, ses inventaires et ses souvenirs, mais également, plus concrètement, si je l’avais suivi de son enfance rue Vilin […] au village d’origine de son père, Lubartow ».
Z ou souvenirs d’historienne est un récit joueur, à la fois rigoureux et plein d’humour, sachant que l’un va mieux avec l’autre : la rigueur sans humour ou l’humour sans rigueur, ça ne donne pas grand chose qu’on ait envie de lire. Ainsi, pour commencer par l’anecdotique, on apprend dans une « tentative d’inventaire non exhaustif […] » qu’elle a perdu pas mal de stylos, dont deux Pilot capless à plume, et ailleurs, qu’elle supporte le R.C. Lens, club de football dont elle peut porter l’écharpe et le maillot au stade Bollaert. Elle a aussi assisté à Buenos Aires au fameux derby de la ville entre Boca et River, moment inoubliable (pour quiconque aime le football). Elle rendait alors visite à ses grands-tantes qui parlent yiddish, avec sans doute l’accent portègne. Mais ça, elle ne le dit pas. Ce qu’elle dit, en revanche, c’est que l’intérieur de leur appartement était semblable à celui de son grand-père à Roanne, alors que les trajectoires étaient très différentes. La jeune normalienne, qui maitrise toute la « grammaire de la francité » en est plus qu’étonnée.
Claire Zalc est une chercheuse des plus sérieuses, et inventive. Son savoir fut très précieux à Ruth Zylberman lorsqu’elle racontait l’histoire du 209 rue Saint-Maur dans un film documentaire passionnant et émouvant. Mais c’est surtout dans son domaine de recherche qu’elle prouve cette inventivité. Elle travaille sur la condition des migrants juifs dans l’entre-deux guerres, et notamment à Lens. L’ouvrage qui en est sorti, co-écrit avec Nicolas Mariot, est Face à la persécution. 991 Juifs dans la guerre. Le nombre n’est pas indifférent, comme elle l’explique ici, puisqu’il a pu fluctuer, au gré des recherches et des découvertes dans les archives. Et pour commencer, qu’est-ce qu’un juif de Lens ? La ville a sa périphérie et des habitants des cités voisines ont été déportés, comme ceux de la métropole.
On est d’emblée frappé par la présence des noms propres. Ces Juifs de Lens, c’est comme si elle les avait connus, toutes et tous, qu’elle pouvait les identifier un par un. Ces commerçants privés de tout par la France de Vichy, elle les a retrouvés par les registres de commerce, et par les crédits qu’ils avaient contractés pour faire fonctionner leurs affaires. C’est concret, factuel, parfois difficile à saisir pour le pur littéraire qui la lit. L’autrice enseigne, parmi d’autres matières, les mathématiques pour littéraires. La statistique, les travaux liés aux nombres en sciences sociales semblent n’avoir pas de secrets pour elle.
Plus proche de nous est la partie qui reprend les procédés de Perec, ou les titres de ses œuvres. Ainsi, « Trois bureaux retrouvés », qui reprend de loin le texte de son écrivain de chevet sur les « Trois chambres retrouvés », ou « Quelques-unes des choses qu’il faudrait tout de même que je fasse avant de mourir », ou encore les « Je me souviens » qui ont sans doute fait la célébrité de l’écrivain même s’il empruntait lui-même l’exercice à Joe Brainard. Claire Zalc s’amuse et honore. Elle rappelle la puissance créative de cette écriture, toujours stimulante. On a envie de reprendre les formes, les jeux, de se glisser dans l’œuvre de Perec, sans jamais oublier que sous ces formes, il y a l’émotion. Ainsi quand elle évoque les « lieux d’une fugue » : « Mes disparus sont à la lisière. Je n’ai de cesse de les contourner. Ma propre démarche reste cantonnée, l’air de rien, à la figure de la fugue. Cette forme d’écriture musicale dans le style du contrepoint, exploite le principe de l’imitation […] Derrière les voix des Szulewicz et des Perec se cachent sans nul doute celles des Strauss et des Zalc, des Knaster et des Duvernoy, des Loeb, des Juda, des Abraham et Sarah, bonnetiers arrivés en France en 1947 auxquels on refusa la nationalité française lors de leur première demande, en 1954, des Caroline, Hedwig dite Hedda ou de la jeune Liese, Juives allemandes qui cherchèrent refuge dans la France des années 1930, y furent arrêtées et déportées en 1942, et de tous les autres. »
« Ses notes sur ce que je cherche » mettent bien en relief ce que devient la recherche en Histoire, aujourd’hui. Loin d’être la matière qu’on voudrait ici ou là figer pour ne retenir que figures héroïques (ou pas, c’est selon) et dates mémorables (ou pas, là aussi c’est selon), elle la vit comme un carrefour : ses interrogations sont sociologiques, autobiographiques, ludiques et romanesques. Ces adjectifs disent beaucoup, et notamment que l’on aime l’Histoire parce qu’on a aimé les récits, parce qu’elle traverse nos vies, faisant écho à nos histoires. Quant au ludique, à la contrainte, on sait que celle-ci rend libre. Les oulipiens l’ont prouvé, et pas seulement eux : nos grands écrivains.
Terminons sur un dilemme que Maurice Olender, éditeur de Perec, entre autres, pose à l’autrice : que retiendra-t-on dans des siècles : Hilberg ou Grumberg, Fridländer ou Mendelsohn ? On voudrait dire tous les quatre, et Lanzmann pour Shoah, et Modiano pour Dora Bruder et j’en oublie. Pour une chercheuse qui puise dans les archives, dans les registres de commerce, qui croise les chiffres, la question est plus délicate. La réponse qu’apporte Claire Zalc en publiant ce livre est sa façon à elle de ne pas choisir.
Norbert Czarny, Après Auschwitz, n°355-356, Juillet – Septembre / Octobre – Décembre 2021
